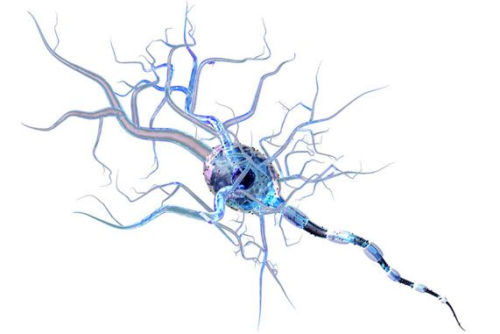Maladie de Parkinson : facteurs environnementaux et prévention
Publié le 02 octobre 2018 à 10:46Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°74
La maladie de Parkinson, deuxième maladie neurodégénérative en termes de fréquence après la maladie d’Alzheimer, concerne près de 170 000 personnes en France.
Vingt-cinq mille nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année dans notre pays. Dans la moitié des cas, elle débute avant soixante-quinze ans ; elle est plus rare mais non exceptionnelle avant l’âge de 50 ans[1].
Les causes sont multiples, mais certains facteurs environnementaux pourraient être impliqués, en particulier les agents phytosanitaires (herbicides, insecticides, pesticides). Des mesures préventives collectives et individuelles peuvent être envisagées.
Qu’est-ce que la maladie de Parkinson ?
Il s’agit d’une maladie neurodégénérative dont le cœur lésionnel est le système à dopamine. La majorité des cellules qui synthétisent ce neurotransmetteur sont situées dans la partie haute du tronc cérébral (dans la substance noire ou Locus Niger). Elles envoient des projections axonales dans des structures cérébrales profondes, les noyaux gris centraux (en particulier le striatum).
Leur dégénérescence conduit à un déficit en dopamine dans ces structures à l’origine de l’essentiel de la symptomatologie. Cette dernière est avant tout motrice avec le classique tremblement de repos qui n’est toutefois pas systématique, mais surtout des difficultés gestuelles liées à l’akinésie, un symptôme constant, indispensable au diagnostic, et une rigidité, dite plastique qui volontiers cède par à‑coup (signe de la roue dentée).
Il existe aussi tout un cortège de manifestations non motrices, comme la douleur, la fatigue, les troubles du sommeil et des symptômes anxiodépressifs, moins visibles mais tout aussi invalidants[2].
La « formule » symptomatologique est très variable d’un patient à l’autre et varie en cours d’évolution. Le plus souvent, elle est asymétrique sur le plan moteur, reflet de l’asymétrie du déficit en dopamine dans les noyaux gris centraux.
Pourquoi est-elle qualifiée de synucléopathie ?
Au niveau cérébral, il existe des dépôts anormaux d’une protéine particulière, l’alphasynucléine. La maladie de Parkinson et d’autres affections dégénératives plus rares où des dépôts anormaux de cette protéine sont aussi observés, constitue le groupe à présent nommé des synucléopathies.
L’alphasynucléine a un rôle important au niveau des synapses, la structure de communication entre les cellules nerveuses.
Pour donner suite à une anomalie de conformation (la séquence d’acides aminés est le plus souvent normale), l’alphasynucléine s’agrège au sein du corps des cellules à dopamine et d’autres cellules cérébrales sous forme d’inclusions arrondies, les corps de Lewy, et au niveau de certaines terminaisons nerveuses, les neurites de Lewy. Ces agrégats anormaux pourraient être à l’origine de dysfonctionnements cellulaires responsables de la dégénérescence des cellules[3].
Des dépôts anormaux de cette protéine sont aussi observés en dehors du cerveau en particulier dans le système nerveux entérique.
Certains scientifiques ont émis l’hypothèse d’une possible initiation de la maladie au niveau du système nerveux entérique avec l’entrée d’un phénomène pathogène à ce niveau (par exemple sous l’effet d’un toxique ou d’un agent infectieux) qui pourrait ensuite se transmettre au cerveau et s’étendre alors de proche en proche, avec un mode de diffusion proche de ce qui est observé dans les maladies à prions (comme la maladie de Creutzfeld Jakob)[4]. Cette hypothèse reste encore loin d’être prouvée[5].
Pourquoi la maladie se développe-t-elle ?
Ce qui est à présent certain, c’est que cette maladie n’a pas une cause unique. Dans 10 à 15% des cas, une mutation dans un seul gène suffit à entraîner la maladie (forme dite monogénique). Il peut s’agir d’une hérédité autosomique dominante (la mutation délétère est présente sur un seul des deux exemplaires du gène [hétérozygote]; elle se transmet donc de génération en génération avec une probabilité de transmission de 50%; à noter que la pénétrance n’est souvent pas complète et donc des sujets porteurs de la mutation délétère peuvent ne pas présenter de leur vivant de signe manifeste de maladie.
Les mutations les plus fréquentes pour ce type de transmission concernent le gène dit LRRK2 (présents dans 30% des formes familiales ou sporadiques en Afrique du Nord) et le gène de l’alphasynucléine, la protéine présente sous forme d’agrégats anormaux dans le cerveau des patients.
Il peut aussi s’agir d’une hérédité autosomique récessive, une mutation délétère doit être présente sur chacun des deux exemplaires du gène [homozygote]; elle ne s’exprime que dans une seule génération, car les sujets atteints ont hérité d’un gène délétère de leur mère et d’un gène délétère de leur père, mais ces derniers n’ayant qu’un gène délétère [hétérozygote] n’ont aucune symptomatologie ; de même la maladie ne se transmet en général pas à la génération suivante, car le sujet malade ne transmet qu’un seul de ces deux gènes porteurs de mutation délétère. Aujourd’hui plus de vingt mutations génétiques sont identifiées pour être à l’origine de maladies de Parkinson monogéniques[6].
Les progrès technologiques en génétique et l’utilisation de consortium internationaux qui permettent l’analyse d’échantillons d’ADN de plusieurs dizaines de milliers de patients ont permis d’identifier certaines variantes ou mutation de gènes comme prédisposant à la maladie. Ainsi une mutation dans le gène de la glucocérébrosidase, connue pour être, lorsqu’elle est présente sur les deux exemplaires du gène (mutation à l’état homozygote), à l’origine d’une maladie dysmétabolique rare, la maladie de Gaucher, est retrouvée sur un seul de gène (état hétérozygote) chez 5% des patients atteints de maladie de Parkinson. C’est le facteur de risque génétique le plus fréquent dans la maladie[7].
Quels facteurs environnementaux sont associés à la survenue de la maladie ?
Dans quelques cas exceptionnels, la maladie de Parkinson (ou en tout cas une forme très voisine) a pu être causée par un toxique environnemental bien identifié. A la fin des années 70 sur la côte Ouest des États-Unis a été observée une « mini-épidémie » de « maladies de Parkinson » chez des sujets jeunes.
Ils avaient pour point commun d’être toxicomanes et d’utiliser la même source d’héroïne. Une fabrication défectueuse de la drogue avait conduit a une production d’un produit particulier, le MPTP, qui s’est depuis révélé être un puissant et sélectif toxique des cellules à dopamine[8]. Le MPTP (1-méthyl-4-phényl-1,2,3,6‑tétrahydroh) est une neurotoxine qui provoque les symptômes permanents de la maladie de Parkinson en détruisant certains neurones dans la substantia nigra du cerveau. Il est utilisé pour étudier la maladie chez le singe.
La majorité des cas de maladies de Parkinson est toutefois, comme c’est le cas pour la plupart des maladies, d’origine multifactorielle avec une combinaison, variable d’un patient à l’autre, de facteurs de prédisposition génétique et de facteurs environnementaux. Sauf dans le cas particulier du MPTP où une claire relation causale entre l’agent toxique et la maladie a pu être montrée, la plupart des études qui cherchent à analyser l’impact de l’environnement sur le développement de la maladie sont des études qui visent à montrer une association entre un facteur environnemental donné et la survenue de la maladie. Ces études donnent ainsi des risques de développement de la maladie en cas d’exposition à un facteur environnemental par rapport à une non-exposition ou une exposition moindre à ce facteur environnemental.
Cela fait apparaître les difficultés de ce type d’approche, en particulier pour détecter les facteurs de risques environnementaux qui ne sont en cause que chez un faible nombre de patients ou lorsque l’exposition à l’agent environnemental est cumulée sur un grand nombre d’années ou a eu un impact des années avant la survenue des premiers symptômes. En outre si la responsabilité causale peut être suspectée, elle ne peut presque jamais être formellement démontrée. Il faudrait pour cela exposer de façon randomisée une partie des individus à un toxique donné (les autres servants de témoins), ce qui est bien sûr impossible.
Plusieurs études épidémiologiques ont mis en évidence un risque accru de maladie de Parkinson en cas d’exposition à des quantités élevées de pesticides[9]. Parmi les études sur ce sujet, une étude française a par exemple mis en évidence l’impact des doses cumulées de pesticides chez les agriculteurs sur le risque de développement de la maladie[10].
Il a pu être par ailleurs montré que certains de ces agents phytosanitaires, comme la roténone®, sont dans certaines conditions expérimentales toxiques pour les cellules à dopamine[11]. La responsabilité des pesticides est par conséquent assez vraisemblable, au moins chez certains patients très exposés. La maladie de Parkinson peut d’ailleurs être reconnue en maladie professionnelle si la preuve d’exposition à des quantités importantes d’agents phytosanitaires est faite.
Des études épidémiologiques ont suggéré qu’une consommation importante de produits laitiers augmentait le risque de survenue de maladie de Parkinson[12].
Différents mécanismes ont été proposés. Une concentration de produits phytosanitaires à partir de l’alimentation des animaux est assez peu probable. Les pâturages ne nécessitent pas de traitement particulier. Les concentrations en toxiques dans le lait sont en outre étroitement surveillées. L’autre hypothèse plus communément avancée est à travers une action possible des produits laitiers sur les taux d’acide urique[13].
Des taux élevés d’acide urique, qui pour mémoire augmentent le risque de goutte et les risques cardiovasculaires, pourraient avoir un rôle protecteur sur les cellules à dopamine. Il est en outre retrouvé une moins grande fréquence de maladie de Parkinson en cas de taux d’acide urique élevés. Cette hypothèse impliquerait que les produits laitiers diminuent le taux d’acide urique ce qui reste à démontrer.
Une étude épidémiologique récente sur deux cohortes importantes (plus de 120 000 sujets au total), dans lesquelles était suivie la consommation de produits laitiers montre somme toute un niveau de risque modeste. Il est en fait présent pour les fortes consommations de produits laitiers allégés (plus de 3 portions américaines/jour soit environ 5 portions françaises) et de « frozen yoghurts ». Aucun lien n’est retrouvé avec les produits laitiers entiers [14].
Il existe enfin une association entre le développement d’un mélanome et la survenue d’une maladie de Parkinson. Les raisons qui sous-tendent cette association ne sont pas parfaitement connues.
À l’opposé, certains facteurs environnementaux sont associés à une diminution du risque de maladie.
Celui qui a été retrouvé dans un grand nombre d’études est la consommation de tabac.
En d’autres termes, fumer réduirait le risque de survenue de maladie ! Et ce même après correction par la surmortalité provoquée par le tabac[15]. Différentes explications ont été proposées et restent sujettes à discussion. La nicotine pourrait avoir un rôle neuroprotecteur, un rôle qui n’a pas été à l’heure actuelle, confirmé par des études cliniques. D’autres constituants présents dans la fumée, comme le monoxyde de carbone pourrait jouer un rôle. L’association pourrait être le fait de facteurs plus indirects.
La dopamine joue un rôle important dans les phénomènes addictifs. Des caractéristiques du système à dopamine qui prédisposeraient à l’addiction au tabac pourraient être ainsi associées à un moindre risque de développement de la maladie. Une réduction de risque de maladie a été aussi observée avec la consommation de café et de thé noir, ainsi qu’avec la pratique sportive.
Est-il possible de prévenir la maladie ?
Le rôle possible des agents phytosanitaires justifie de limiter leur exposition. Pour les professionnels comme pour les particuliers, préférer des méthodes naturelles et limiter l’usage au minimum indispensable sans oublier le port de protection (gants, lunettes, masque) sont des mesures de bon sens.
En l’absence de connaissances plus précises sur les mécanismes de la maladie, il n’y a pas d’autres mesures préventives spécifiques à envisager actuellement. La symptomatologie parkinsonienne ne se développe que lorsque le manque de dopamine cérébrale est conséquent (plus de 70%). Le cerveau possède donc de fortes capacités de compensation qui lui permettent de fonctionner longtemps normalement alors qu’il existe un déficit marqué en dopamine.
Il est probable que l’activité physique régulière (qui est effectivement associée à un risque moindre de maladie comme vu ci-dessus), la stimulation cognitive et le maintien du lien social soient des éléments de renforcement de ces capacités de compensation, comme cela a été montré dans la maladie d’Alzheimer avec la notion de réserve cognitive. Le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire pour éviter les lésions cérébrales vasculaires participe au maintien de cette « réserve » et de capacités de compensation.
Garder un cerveau en bonne forme, par une hygiène de vie appropriée et une activité physique régulière, permet vraisemblablement de mieux s’armer contre la survenue de la maladie de Parkinson et des maladies neurodégénératives en général et ainsi en retarder tant le moment de leur expression symptomatique que leur évolution vers des complications difficiles à gérer.
Vers de nouvelles pistes thérapeutiques ?
Les traitements actuels, médicamenteux et chirurgicaux (neurostimulation cérébrale), sont symptomatiques. Ils visent à corriger le déficit en dopamine cérébrale ou ses conséquences. Ils sont efficaces sur la plupart des symptômes moteurs de la maladie, mais peuvent être source d’effets indésirables. Ils ne jouent cependant pas sur l’évolution de la maladie et en particulier sur sa diffusion à des systèmes non dopaminergiques.
Une meilleure compréhension des mécanismes à l’origine de la maladie permettra d’améliorer les traitements actuels. L’identification plus précise de facteurs prédictifs d’évolution, de réponse au traitement en termes d’efficacité comme de développement d’effets indésirables permettra d’amplifier la personnalisation de l’approche thérapeutique dans les années à venir. Le soutien à la recherche est donc déterminant. Parmi les nouveaux traitements, l’immunothérapie est une des pistes encourageantes à moyens termes. Le principe est de tenter par l’administration d’anticorps monoclonaux d’éliminer les dépôts anormaux d’alphasynucléine dans le cerveau[16].
La thérapie cellulaire, même si elle fait souvent les grands titres de la presse est probablement encore loin d’être une solution. Difficile en effet de reconstruire par la simple administration de cellules dopaminergiques ou de cellules souches un système à dopamine qui s’est mis en place sur de nombreux mois par le jeu d’une interaction complexe avec de multiples systèmes nerveux et gliaux lors de la vie fœtale et de la petite enfance.
En conclusion
Les facteurs à l’origine de la survenue d’une maladie de Parkinson restent encore inconnus dans la grande majorité des cas. L’identification des mutations génétiques en cause surtout et de certains facteurs environnementaux comme le MPTP a permis de progresser dans la compréhension des mécanismes à l’origine des lésions des cellules à dopamine. Certains de ces mécanismes sont probablement communs à un grand nombre de patients, quelle que soit la cause à l’origine de leur déclenchement. Agir sur ces mécanismes pourrait ainsi permettre dans le futur de ralentir l’évolution de la maladie.
Pr Philippe Damier
Neurologue, CHU Nantes
Président du Comité scientifique sciences médicales, cliniques de France Parkinson
Bibliographie :
[1] Santé Publique France Bulletin épidémiologique hebdomadaire N° 8 – 9, 10 avril 2018. http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/8- 9/pdf/2018_8‑9.pdf
[2] Kalia LV, Lang AE. Parkinson’s disease. Lancet 2015 ; 386:896 – 912.
[3] Wong YC, Krainc D. ‑synuclein toxicity in neurodegeneration : mechanism and therapeutic strategies. Nat Med 201 ; 23:1 – 13.
[4] Brundin P, Melki R. Prying into the Prion Hypothesis for Parkinson’s Disease. Neurosci 2017 ; 37:980818.
[5] Surmeier DJ, Obeso JA, Halliday GM. Parkinson’s Disease Is Not Simply a Prion Disorder. J Neurosci. 2017 Oct 11;37(41):9799 – 9807
[6] Puschmann A. Monogenic Parkinson’s disease and parkinsonism : clinical phenotypes and frequencies of known mutations. Parkinsonism Relate Discord 2013 ; 19:407 – 15.
[7] O’Regan G, de Souza RM, Balestrino R, Schapira AH. Glucocerebrosidase Mutations in Parkinson disease. J Parkinson Dis 2017 ; 7:411 – 22.
[8] Snyder SH, D’Amato RJ. MPTP : a neurotoxin relevant to the pathophysiology of Parkinson’s disease. The 1985George C. Cotzias lecture. Neurology 1986 ; 36:250 – 8.
[9] Ascherio A, Schwarzschild MA. The epidemiology of Parkinson’s disease : risk factors and prevention. Lancet Neurol 2016 ; 15:1257 – 72.
[10] Elbaz A, Clavel J, Rathouz PJ, Moisan F, Galanaud JP, Delemotte B, Alpérovitch A, Tzourio C. Professional exposure to pesticides and Parkinson disease. Ann Neurol 2009 ; 66:494 – 504.
[11] Betarbet R, Sherer TB, Mac Kenzie G, Garcia-Osuna M, Panov AV, Greenamyre JT. Chronic systemic pesticide exposure reproduces features of Parkinson’s disease. Nat Neurosci 2000 ; 3:1301 – 6.
Transmis par Dominique Bonne
Information importante : Rupture de stock de médicament pour le Sinemet®
Publié le 13 septembre 2018 à 18:01L’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament) vient de nous informer des ruptures suivantes :
- SINEMET 250mg/25mg : rupture à compter de fin août 2018
- SINEMET 100mg/10mg : rupture à compter de mi-septembre 2018
- SINEMET LP 200mg/50mg : une rupture risque de se produire à compter de la 3ème semaine d’octobre 2018
Lisez en urgence le communiqué : suivez ce lien (au format .pdf)
[vu sur le net] — Un cours en ligne pour mieux comprendre la maladie de Parkinson
Publié le 11 septembre 2018 à 19:15article trouvé sur le site agevillage.com
Pour aider les particuliers à mieux comprendre la maladie, l’université de Nantes lance un cours en ligne gratuit (mooc) sur la maladie de Parkinson, élaboré en partenariat avec France Parkinson.
Pour lire cet article dans son intégralité, suivez ce lien …
[vu sur le net] Parkinson : la zone du cerveau responsable des douleurs chroniques des malades a été identifiée
Publié le 04 septembre 2018 à 15:11article trouvé sur le site de Sciences et Avenir
Sensations de brûlures, de fourmillements ou de coups de poignards, les douleurs chroniques ressenties par les malades de Parkinson seraient dues à une vitesse de transmission accélérée de l’information de douleur dans une zone de leur cerveau, d’après une nouvelle étude.
pour lire l’article dans son intégralité, suivez ce lien …
[vu sur le net] Parkinson : des troubles du contrôle des impulsions fréquents chez près de la moitié des patients traités
Publié le 02 août 2018 à 15:43article trouvé sur le site de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière
Une étude menée par des médecins et chercheurs de l’hôpital Pitié-Salpêtrière, AP-HP, Sorbonne Université et du Centre de recherche en Epidémiologie et Santé des Populations, Inserm, a analysé les données d’une cohorte, coordonnée par l’AP-HP, de 400 patients atteints de la maladie de Parkinson. Elle révèle que les troubles des impulsions, des effets secondaires observés tels que des addictions aux jeux et aux achats ou une hypersexualité, sont fréquents chez les patients traités. Ils touchent près de la moitié des patients suivis 5 ans plus tard, et sont fortement associés à la dose et à la durée du traitement par agoniste dopaminergique.
Pour lire cet article dans son intégralité, suivez ce lien …
É N E R V A N T
Publié le 25 juillet 2018 à 13:28Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°73
ÉNERVANT, c’est le seul mot qui me vient à l’esprit quand je pense à ma maladie : la maladie de Parkinson.
ÉNERVANT, de ne savoir quoi répondre quand on me demande « Comment tu vas ? » surtout si la question est « tu as l’air d’aller mieux ? » en effet la sensation de bien-être est tellement fluctuante.
ÉNERVANT, d’avoir plus de difficulté à s’habiller qu’à déplacer de lourdes charges. ÉNERVANT, quand on me propose de m’aider dans des actions demandant un effort physique, mais que l’on me laisse faire des tâches simples qui représentent pour moi de bien plus de difficultés.
ÉNERVANT, les conseils : « n’oublie pas tes médicaments, mange correctement, couche-toi plus tôt, ½h pour les mouvements du matin, ½h pour la marche, ½h pour l’entraînement à l’écriture, etc. »
ET QUAND est-ce que je fais ce qui me plait ? Voir des amis, bricoler, faire le jardin, etc.
ÉNERVANT, quand je dis quelque chose et que la personne ne répond pas car elle ne s’est même pas aperçue que je parlais et quand elle le voit, énervant de répéter car elle n’a rien entendu.
ÉNERVANT, que toutes les petites misères liées à la maladie (problèmes de vue, fausses routes, problèmes urinaires, crampes, etc.) ne semblent pas acceptées comme telles par l’entourage qui pense que ce n’est pas lié à la maladie mais plutôt à l’âge !!!!
ÉNERVANT, de ne pouvoir se retourner dans le lit.
ÉNERVANT, d’avoir des difficultés à mettre des chaussettes.
ÉNERVANT, d’avoir du mal à écrire un chèque.
ÉNERVANT, d’avoir des somnolences en journée dès que je ne suis plus occupée et de ne pas avoir envie de se coucher de la nuit.
ÉNERVANT, de ne plus pouvoir faire deux choses en même temps, de démarrer une tache en oubliant celle que j’ai en cours dans l’autre pièce.
ÉNERVANT, de ne plus avoir cette grande capacité de concentration que j’avais auparavant.
ÉNERVANT, cette émotivité constante qui amène les larmes aux yeux sans raison. Je ne peux plus raconter des anecdotes sans les simplifier, si bien que mon discours devient inconsistant.
Et pourtant, j’ai une chance inouïe par rapport à d’autres parkinsoniens :
- J’ai des médecins (généraliste et neurologue) formidables qui ont détecté la maladie en deux mois, et j’ai eu la prise en charge (ADL) en trois mois.
- J’ai une kiné et une orthophoniste qui connaissent bien la maladie, elles m’aident beaucoup et m’entourent de sympathie.
- Pour l’instant, ma maladie ne se voit pas trop. Je reste indépendante et elle ne me perturbe pas trop dans mes activités.
- Personne, ni dans la famille, ni parmi les amis ne m’a fait faux bond et à part une ou deux personnes, ils continuent de voir « Bernadette » et pas « une malade ». Tous restent discrets sur mes « somnolences » à table, même au restaurant.
- En plus, à travers les associations, cette maladie m’a donné une occupation toute trouvée pour la retraite et… beaucoup d’amis!!!
Mais malgré tout, qu’est que c’est ÉNERVANT!!!
Bernadette, février 2013
Transmis par Hélène Le Dref
Les chaussures minimalistes ou « chaussures à orteils »
Publié le 23 juillet 2018 à 03:06Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°73
Souffrant de « crampes du pied » (dystonie : les orteils qui se recroquevillent dans la douleur, les personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson connaissent…) qui peuvent survenir n’importe quand lors de la marche, mais de préférence en randonnée, j’en étais réduite à ne plus me promener seule en forêt et à écourter mes balades : avec la hantise de la crampe, cela n’avait plus grand-chose de réjouissant… Mais il ne faut pas s’avouer vaincu… C’est en réalisant que pieds nus ou en sandales légères j’avais moins de crampes et qu’en tous cas j’arrivais plus facilement à remettre en place les orteils – et donc à faire passer la crampe, que j’ai pensé aux chaussures minimalistes.

Elles ne sont pas très connues mais vous en avez peut-être déjà vu, ce sont des chaussures qui évoquent des gants de pieds, elles interfèrent le moins possible avec les mouvements naturels du pied. On a ainsi les sensations de la marche – ou de la course pour les sportifs – pieds nus, sans leurs inconvénients grâce à une semelle très fine étudiée pour amortir les chocs… J’en avais déjà entendu parler à propos de course à pied, un milieu où elles commencent à être très appréciées, mais c’est un article de la revue Alternatif Bien-Être (n°126, mars 2017) qui m’a convaincue d’en acheter une paire : avec des orteils bien séparés, déjà me serait-il plus facile de lutter contre les crampes ?
« Quand on est sujet aux « crampes de pied », se chausser devient un problème, qui s’ajoute aux difficultés parkinsoniennes pour trouver la bonne position pour s’asseoir, se baisser, enfiler la chaussure, faire les lacets etc.
L’article d’Alternatif Bien-Être présente les bienfaits que procureraient les chaussures minimalistes d’après quelques études en anglais et des témoignages d’usagers :
« Développement de votre équilibre et de votre proprioception : grâce à la flexibilité et à la fine épaisseur de sa semelle, le pied est beaucoup plus proche du sol, les récepteurs proprioceptifs captent pleinement la pression exercée sur la voûte plantaire. Ainsi, en marchant avec des chaussures minimalistes, vous stimulez votre système vestibulaire (le système de l’équilibre). Un système vestibulaire réactif est capital pour prévenir le risque de chute ou de blessure. (…)
Travail de votre mobilité : dans une chaussure minimaliste, les doigts de pieds sont nettement moins compressés que dans une chaussure maximaliste. Le gros orteil, par exemple, a besoin d’espace et de flexibilité pour pouvoir pleinement vous aider lors des changements de direction et dans le maintien de l’équilibre.
Stimulation de la neurogénèse : une étude intéressante parue dans le journal Médical Hypothèses en 2016 suggère que marcher avec des chaussures plates stimulerait notre neurogénèse, c’est-à-dire le renouvellement et la croissance de nos neurones au fil du temps, et entraînerait une diminution des maladies du système nerveux telle la démence sénile. En effet, la suppression de l’épaisseur du talon et la fine épaisseur de la semelle permettent au pied de se poser horizontalement sur le sol. Du coup, les récepteurs de la voûte plantaire peuvent fournir une meilleure cartographie au système nerveux. Ce dernier est donc sollicité plus largement, ce qui stimule sa croissance et ses performances.
Réduction de l’arthrose : une étude publiée dans Arthritis & Rheumatism démontre que marcher pieds nus et la marche minimaliste réduiraient de façon significative la pression exercée sur les genoux par rapport à des chaussures conventionnelles. Dans cette étude, les résultats ont démontré une réduction de 18 % de la force imputée aux genoux ainsi qu’une réduction de la douleur de 36 %.
Meilleure circulation du sang : comprimer son pied et l’enfermer dans une chaussure conventionnelle serait nettement plus néfaste pour la circulation sanguine. La marche minimaliste diminue la viscosité du sang et participe à la prévention des varices et des maladies cardiaques
Meilleure posture : un talon épais avec amorti modifie notre posture naturelle et entraîne bien souvent des compensations d’ordre postural. Nous sommes contraints de nous pencher vers l’avant, forçant nos hanches et le bas de notre dos à compenser comme ils peuvent. En prenant l’habitude de marcher pieds nus ou en chaussures minimalistes, les terminaisons nerveuses de notre voûte plantaire peuvent nous renseigner sur la position de notre corps.
De nombreux marcheurs minimalistes témoignent d’une amélioration de leur posture ainsi que d’une diminution progressive des douleurs de genou, de hanche et de dos. La randonnée ou marche nordique agissent déjà positivement sur la pression artérielle, la fréquence cardiaque au repos, le renforcement des os et la prévention de l’ostéoporose, l’entretien des articulations. Elles libèrent des endorphines qui diminuent le stress et stimulent votre métabolisme. En somme, déjà de nombreux atouts santé. La science d’aujourd’hui démontre de plus en plus que la marche minimaliste serait encore plus bénéfique pour la santé globale, alors pourquoi ne pas s’y mettre ? Si cette pratique vous tente, je vous recommande une phase transitoire où vous pouvez alterner des chaussures conventionnelles et des chaussures minimalistes à chaque sortie pour laisser le temps à vos pieds de s’adapter. »
Vous pouvez vous tourner vers des marques comme Vivobare-foot, Vibram Fivefingers, Merrell ou encore Inov8 qui proposent des chaussures minimalistes pour la marche comme pour la course à pied à des prix allant de 70 à 230 euros. Le mieux est d’essayer en boutique spécialisée ou, à défaut. N’ayant trouvé aucune boutique spécialisée, j’ai acheté mes chaussures sur internet, la plupart des sites proposent le retour gratuit si ça ne va pas. J’ai choisi un des modèles les moins chers et les plus légers (peur de ne pas arriver à enfiler les modèles « treck » par ex.), Alitza Loop de Vibram five fingers.
On les porte sans chaussettes, ça n’est pas gênant. Sinon il existe des chaussettes « à orteils », mais dans ce cas il vaut mieux prévoir une pointure de plus car ces chaussures taillent un peu serrées. On peut aussi commencer par acheter juste des chaussettes à orteils (sur internet, à partir de moins de 10 euros) et les porter juste dans la maison pour habituer les pieds à avoir les orteils bien séparés.

J’ai été agréablement surprise à la réception, pas eu besoin d’échanger : j’ai les orteils qui sont plutôt serrés et biscornus mais ils ont tous facilement trouvé leur compartiment. Je pensais galérer pour enfiler ces chaussures, pas de difficulté si je suis bien installée, et cela me prend beaucoup moins de temps que pour mes chaussures fermées, avec lesquelles j’ai des crampes à tous les coups.
Je croise les doigts –de mains ! – , justement, des crampes depuis une semaine avec mes chaussures minimalistes, je n’en ai toujours pas eu ! Je revis !! Je n’ai pas encore testé sur de grandes balades d’une heure ou plus, juste des petites marches en forêt. Ces chaussures sont plus légères que des ballerines. Les semelles amortissent bien les chocs, la sensation de marche est très agréable, spontanément je me tiens mieux, je marche plus vite aussi, le moral s’en ressent… Au repos, mes orteils sont plus détendus, et moins serrés, je n’arrive pas encore à avoir les doigts de pied en éventail mais ça s’en approche. Je ne suis pas la seule à trouver mes chaussures jolies, elles attirent l’attention. À suivre, je reviendrai compléter cet article plus tard.
Mireille Saimpaul (Parkinette)
Vous avez dit « aidants » ?
Publié le 16 juillet 2018 à 08:56Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°73
Acteurs éminents, indispensables dans la prise en charge de la perte d’autonomie, ils sont un complément nécessaire aux personnels de l’aide à domicile. Qui sont –ils ? L’aidant familial est la personne qui vient en aide à titre non professionnel, en partie ou totalement à une personne âgée dépendante ou à une personne handicapée de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne. Elle peut prendre différentes formes comme le nursing les soins, l’accompagnement à la vie sociale, les démarches administratives, la coordination, la vigilance, le soutien psychologique, les activités domestiques.
État des lieux
On estime en 2008 (derniers chiffres publics) à 8,3 millions les aidants familiaux d’une personne âgée, en situation de handicap, souffrant d’une maladie chronique lourde, eux-mêmes âgés de 16 ans et plus. Les femmes représentent 57% des aidants, 47% des aidants occupent un emploi. La famille proche est au cœur de l’aide apportée : 62% sont les conjoints, 13% sont les enfants quand ils vivent ensemble.
Comment expliquer ce phénomène ?
Réticence à recourir à une personne tierce pour des soins personnels, soutien moral plus facile, question financière, ignorance des droits. Cependant, les configurations d’aide mixte, articulant aidants et professionnels sont les plus courantes.
Les impacts négatifs sur les différents aspects de la vie des aidants sont nombreux. La charge ressentie se traduit par des effets physiques, psychologiques, émotionnels, sociaux et financiers. Elle est plus importante chez les femmes, 20% des aidants ressentent une fatigue morale ou physique importante. Les vies personnelle, familiale et sociale sont les plus affectées. Enfin l’impact sur la santé est important.
Le droit au repos : où trouver les informations ?
Code de l’action sociale et des familles : articles l232‑3 – 2, D2326961 ? R232-27 (Droit au Répit)
Code du travail : articles L3142-16 à 27, D3142‑7 à 13 (droit au congé du proche aidant)
https://www.pour-les-personnes-agées.gouv.fr/.
Diverses rubriques renseignent sur : vivre à domicile, vivre ailleurs temporairement, choisir un hébergement, bénéficier d’aides, exercer ces droits, aider un proche, à qui s’adresser…
Transmis par Nicole Lecouvey
[vu sur le net] — Vers un fond d’indemnisation des victimes de pesticides ?
Publié le 13 juillet 2018 à 14:09article trouvé sur le site Santé Magazine
La question de l’indemnisation des victimes de pesticides reste délicate à régler. En février 2018, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, avait jugé « prématurée » la création d’un fonds spécial abondé par les fabricants de produits phytosanitaires. L’Assemblée nationale avait alors refusé de l’inscrire à son programme.
Mais le Sénat en a jugé autrement. Le 2 juillet dernier, les sénateurs ont réintroduit un article dans le projet de loi sur l’agriculture et l’alimentation, projet qui doit prochainement repasser devant les députés.
Hier, 10 juillet 2018, l’association Alerte des médecins sur les pesticides (AMLP) s’est réjoui dans un communiqué de voir l’idée revenir sur le devant de la scène. L’AMLP réclame, néanmoins, certaines garanties.
Pour lire cet article dans son intégralité, suivez ce lien …
Le monde des « aidants », réflexions sur les « aidants naturels »
Publié le 11 juillet 2018 à 10:36Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°73
L’« aidant » est depuis peu juridiquement qualifié. Il est « aidant familial » ou « aidant naturel ». Et la plupart du temps l’aidant est une aidante, ce que d’aucuns trouvent « naturel ».
Michel Billé va plus loin (il est sociologue, président de l’union nationale des instances et offices de retraités et personnes âgées, membre du conseil scientifique des sciences humaines France Alzheimer).
Quel regard porte-t-il sur le monde des aidants ?
Que l’on observe les choses d’un point de vue franco-français, européen et même mondial, la tendance au vieillissement de la population est partout confirmée. On prévoit pour 2025 une population de 12 milliards de « vieux » soit deux fois plus qu’en 2000. Cette réalité démographique nous conduit à reconsidérer notre système de santé, les besoins, les coûts, les performances et les acteurs.
Pourtant, dans la prise en compte du système de santé, l’apport de millions de « soignants » demeure presque toujours ignoré. Ces méconnus du système s’appellent aidants naturels, aidants familiaux, aidants de proximité. Ils prennent soin d’un malade, d’un parent, d’un conjoint, tantôt à leur domicile, tantôt au domicile de la personne aidée.
« Sans doute serait-il plus juste de parler d’aidant « culturel », tant c’est bien un contexte, des modes de vie qui déterminent cette situation. »
Qui sont ces « aidants naturels ? »
Les aidants sont souvent des aidantes. Au fur et à mesure que la population avance en âge et que se transforment les rapports entre générations, la situation des « aidants naturels » retient davantage l’attention, c’est évidemment légitime.
Il faut pourtant s’interroger sur ce que cette situation a de « naturel ».
En effet, les aidants sont des aidantes, chacun le sait, et le recours ici à la « nature » semble remplir une fonction de masque C’est évidemment la culture qui attribue les rôles que nous avons à jouer, désigne les acteurs et, à travers cela, assigne à chacun une place dans le tissu social.
C’est la culture qui attribue aux femmes, épouses, compagnes, filles, belles-filles et petites filles, les fonctions d’éducation des enfants, des soins aux malades, l’aide aux handicapés et maintenant d’aides aux personnes âgées. Ce qui est vrai à domicile l’est aussi en établissement, c’est aussi cette femme qui y assure de manière bénévole la présence familiale, par exemple par sa participation au conseil de vie sociale. C’est un rôle assigné, attribué, qu’elles endossent sans l’avoir choisi, ce qui ne veut pas dire qu’elles le refusent, ni même qu’elles le subissent. Mais est-ce inné de savoir aider ?
Que cache cette fonction de masque ?
Elle construit, sans le dire, une obligation morale adossée à la notion de loyauté familiale. Elle désigne ceux qui sont concernés dans une sorte de périmètre limité, dit de proximité et place hors du champ professionnel, et par conséquent hors des échanges rétribués, l’action des aidants naturels.
On comprend ainsi que la valorisation de l’aide apportée par les proches passe par la reconnaissance de leur engagement, de leur désintéressement et de leur loyauté dans la relation à leurs ascendants. Sans cette reconnaissance, c’est l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes qui se trouve atteinte. Il ne faudrait pas qu’un recours spontané mais abusif à la « nature » leur inflige un surcroît de culpabilité quand, pour quelque raison que ce soit, ils ne peuvent assumer… ce rôle culturellement assigné.
Propos recueilli dans un magazine « pour retraités »
Par Nicole Lecouvey
Demain, éviter la maladie ?
Publié le 10 juillet 2018 à 07:26Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°73
Qui est à risque ? Et qui est responsable ?
S’il est urgent de soulager ceux qui souffrent de la maladie, s’agissant d’en réduire l’impact – on estime qu’il aura doublé d’ici 2030 – la première des questions à élucider n’est-elle pas d’en connaître les raisons : Où ? Quand ? Dans quelles circonstances elle se manifeste ? Il devient alors possible de dégager des pistes de recherche, ou à défaut, d’énoncer des principes de précaution, comme pour l’amiante… Mais en même temps, ces questionnements conduisent immanquablement à poser la question plus délicate des responsabilités… et par voie de conséquences des victimes.
Le dilemme agricole
Aujourd’hui, des débuts de réponses à ces questions se font entendre parmi lesquelles l’agriculture et ses produits miracles (herbicides, pesticides…) qui ont le pouvoir d’éliminer l’indésirable pour faire place au meilleur… mais aussi l’agriculture et ses agriculteurs devenus malades au nom du même miracle.
L’agriculture et ses agriculteurs se retrouvent alors confrontés au choix crucial suivant entre : Soit s’en remettre au bon sens qui recommande la prudence en ne cédant pas au miracle, avec l’avantage d’échapper à l’exposition aux produits soupçonnés, mais aussi l’inconvénient d’être économiquement à contrecourant … Ou bien céder à la pression des tout puissants lobbies (MONSANTOS, BAYER,…) qui suggèrent avec force la voie facile avec l’avantage du résultat, mais aussi l’inconvénient du risque d’être malade…
Drôle de dilemme face auquel l’agriculteur n’est malheureusement pas en mesure d’exercer son libre arbitre, faute d’être complètement et honnêtement informé sur les décisions et leurs conséquences parmi lesquelles celles à plus long terme sur l’environnement ?
La question environnementale.
Car, aujourd’hui les termes de l’enjeu changent. Nous savons que le risque dépasse largement celui de la population des agriculteurs, atteignant aussi les habitants non agriculteur des régions agricoles. Des études territoriales montrent que nous risquons tous d’être atteints par ces produits qui habitent jusqu’au moindre de nos cheveux, et qu’il existe une relation entre la prévalence de la maladie et l’utilisation faite des produits soupçonnés. Cet élargissement a pour effet de « diluer » les responsabilités et vient compliquer la mise en place de principes de précautions.
Seul, que peut-il ?
Mais même avec les meilleurs arguments, que peut aujourd’hui cet agriculteur victime ? Esseulé, lâché par ceux de sa profession qui, rendement oblige, continuent de croire au miracle… Bien qu’ayant remporté une première victoire pour obtenir le statut de maladie professionnelle, que peut-il face aux puissants lobbies de l’agriculture pour que son combat soit reconnu à l’échelle environnementale ? Prêts à tout pour déstabiliser ceux qui s’aventurent sur la voie juridique, ils nient les évidences avec une insolence incroyable, allant jusqu’à mettre en doute l’intégrité mentale de leurs opposants en prétextant la maladie…
Et nous, qu’y pouvons-nous ?
Nos causes n’ont-elles pas vocation à se rencontrer ? Associations de patient, nous sommes aussi des associations de possibles victimes. A ce titre, nous sommes naturellement désignés pour appuyer les associations de défense de l’environnement par des actions d’information, des témoignages contribuant ainsi à « faire la preuve par les victimes » du caractère neurotoxique des produits incriminés.
A défaut de guérison, évitons la maladie chaque fois que c’est possible. Stop à l’empoisonnement de nos campagnes et de leurs habitants. Non seulement nous sommes tous concernés, mais il y va aussi de la santé des générations futures.
A votre avis?…
Sources :
Les pesticides une nouvelle fois mis en cause dans la maladie de Parkinson
Paul François, l’agriculteur qui a fait condamner Monsanto
Rédigé par Yves Gicquel
Publié le 08 juillet 2018 à 09:16
Deux articles parus dans Presse-Océan du 11/04/2018 à l’occasion de la Journée Mondiale Parkinson
1 — Parkinson, une « maladie de vieux » ?
Non, 17% des nouveaux cas ont moins de 65 ans.
Les tremblements, unique symptôme ? Loin de là, ils ne sont pas systématiques. Bien que répandue, cette maladie fait toujours l’objet d’idées reçues. « Parkinson est bien plus complexe que simplement sucrer des fraises » explique Jean-Louis Dufloux lors d’une conférence de presse de l’Institut du Cerveau et de la moelle épinière (ICM) à l’occasion de cette Journée Mondiale.
Âgé de 57 ans, il est atteint de Parkinson et a écrit un livre Cinquante et un pour montrer avec humour qu’il ne s’agit pas « d’une maladie de vieux ». « Les symptômes, ce sont la maladresse, le dérèglement du sommeil : on dort peu, on se lève très tôt, on a des moments de somnolence » détaille-t-il « il y a aussi des sens interdits : on perd l’odorat. On a des moments de dépression, qui se déclenchent sans comprendre. Et la maladie fige les expressions du visage… Cela permet de gagner au poker ! » glisse-t-il dans un sourire.
Parkinson est une maladie neurodégénérative, la deuxième en termes de fréquence, derrière Alzheimer. Au fil de son évolution, le risque de dépendance augmente pour les malades, en raison de complications motrices et cognitives, qui peuvent aller jusqu’à la démence. Elle touche 166.000 personnes en France, soit 2,5 pour 1.000, avec environ 25.000 nouveaux cas par an, selon les derniers chiffres dévoilés en avril 2018 dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) de l’Agence Sanitaire Santé Publique France : 17% des nouveaux cas sont âgés de moins de 65 ans. « Dans un cas sur deux, la maladie débute avant 58 ans, en pleine vie active », souligne Le Professeur Damier, neurologue au CHU de Nantes. En 2030 on estime que 260.000 personnes seront traitées pour la Maladie de Parkinson en France, soit 1 personne sur 120 parmi les plus de 45 ans. « Cela représente une augmentation de 56% par rapport à 2015″ note le BEH.
Les traitements actuels agissent sur les symptômes mais ne guérissent pas la maladie.
2 — Pesticides : Les Riverains sont aussi touchés.
Le risque de Maladie de Parkinson lié aux pesticides ne se limiterait pas aux seuls agriculteurs, mais toucherait aussi la population des régions agricoles, et notamment les viticoles, plus exposées à ces substances, selon une étude publiée en avril 2018.
Une augmentation de la Maladie de Parkinson dans la population générale habitant les cantons français les plus agricoles a en effet été relevée dans une étude épidémiologique nationale. Cette augmentation est observée « y compris après exclusions des agriculteurs » souligne l’éditorial du Bulletin Epidémiologique hebdomadaire (BEH) dédié à la Maladie de Parkinson.
Une explication possible serait que l’utilisation importante des pesticides s’accompagnerait d’une exposition des riverains ces substances.
Lu pour vous par Jacqueline Géfard
Parkinson iatrogène réponse du Dt Stefan Bohlhalter
Publié le 05 juillet 2018 à 06:54Parkinson Suisse N°129
Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°73
Différents syndromes parkinsoniens sont décrits dans le magazine 113. On y trouve le Parkinson iatrogène, déclenché par certaines substances actives chimiques : de quelles substances s’agit-il ?
Il s’agit principalement de substances qui bloquent les récepteurs dopaminergiques susceptibles de déclencher les symptômes parkinsoniens. La plupart d’entre elles appartiennent au groupe des neuroleptiques, qui sont employés pour lutter contre les maladies psychiatriques (psychoses, hallucinations). Certains médicaments contre la nausée et le mal des transports peuvent aussi exercer un effet inhibiteur sur la dopamine et entraîner des symptômes parkinsoniens. Pour les personnes concernées, il est essentiel de savoir que deux médicaments sont à disposition en cas d’hallucinations visuelles : la quétiapine (par ex. Sequase®) et la clozapine (Leponex®). Elles sont autorisées en raison de leur action anti hallucinatoire ciblée sans interaction avec les symptômes parkinsoniens. En cas de nausée, la dompéridone (Motilium®) ou l’ondansétron (Zofran®) peuvent être utilisés : la première n’agit pas sur le système nerveux central et le mode d’action du second est indépendant de la dopamine.
Lu par Jean Graveleau
Attention, des médicaments prescrits contre la dépression et la maladie de Parkinson accentuent les risques de démence
Publié le 04 juillet 2018 à 08:40Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°73
Incontinence, dépression ou encore maladie de Parkinson… les anticholinergiques sont des médicaments prescrits pour lutter contre ces problèmes de santé. Une équipe internationale de chercheurs (des Etats-Unis, d’Irlande et du Royaume-Uni) a mené l’étude la plus large sur l’impact à long terme de ces traitements. D’après les résultats, publiés dans la revue The BMJ, les anticholinergiques sont liés à des risques accrus de démence.
L’exposition aux anticholinergiques est risquée
Les chercheurs ont analysé plus de 27 millions d’ordonnances appartenant à des patients âgés de plus de 65 ans atteints de démence (40 770) et non-atteints de démence (283 933). Ils ont constaté une plus grande incidence de démence chez les personnes qui s’étaient fait prescrire des anticholinergiques. Par ailleurs, plus les patients avaient été exposés à ces traitements, plus leurs symptômes étaient importants.
La démence entraîne une perte de mémoire, des difficultés à s’orienter et une détérioration du comportement social. Selon une étude américaine très récente, elle tend en revanche à apparaître de plus en plus tard et à durer sur des périodes plus courtes.
Des dégâts bien avant la démence.
Autre découverte, les effets indésirables des anticholinergiques peuvent apparaître bien longtemps avant qu’un médecin diagnostique une démence chez un patient. « Les anticholinergiques, ces médicaments qui bloquent acétylcholine, un neurotransmetteur du système nerveux, ont déjà été déterminés comme une cause potentielle de déficience cognitive », détaille Noll Campbell, l’un des auteurs de l’étude. Il poursuit : « Cette étude est assez vaste pour évaluer les effets à long terme de ces traitements et constater que les dégâts peuvent se faire sentir des années avant que le diagnostic de démence ne soit posé ».
Les chercheurs préconisent ainsi aux médecins de bien évaluer les risques des anticholinergiques sur le cerveau avant de les prescrire. Et aussi d’étudier d’autres options de traitement. Il est possible aussi d’agir sur le mode de vie des patients. Car selon des chercheurs, « au moins un cas sur trois pourrait être évité en arrêtant de fumer, en faisant du sport ou encore en compensant des problèmes d’audition ».
Des millions de personnes concernées :
Analyser les risques de ces médicaments est primordial car ils sont largement prescrits, notamment aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Cela tient aussi du fait qu’ils traitent plusieurs maladies. « Cette étude est très importante car on estime que 350 millions de personnes souffrent de dépression dans le monde », déclare ainsi George Savva, auteur principal de la recherche. Il faut y ajouter les personnes qui souffrent d’incontinence, de la maladie de Parkinson, mais aussi d’asthme ou encore d’épilepsie. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 10 millions de cas de démence sont diagnostiqués chaque année. Aujourd’hui, 50 millions de personnes seraient atteintes dans le monde.
Publié le 26 avril 2018 par Johanna Hébert dans « Pourquoi Docteur ».
Transmis par Martine Delmond
Le rôle protecteur du tabac ?
Publié le 03 juillet 2018 à 08:47Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°73
La diminution du risque de maladie de Parkinson observé chez les fumeurs s’expliquerait par une interaction de plusieurs gènes avec le tabac. Restent à déterminer les mécanismes sous-jacents et les composés de la fumée de cigarette impliqués.
Selon les données épidémiologiques, les fumeurs ont un risque d’être atteints par la maladie de Parkinson inférieur de 40% à celui observé chez les non-fumeurs. Le tabac, bon pour la santé ? Ce constat est suffisamment provocant pour susciter l’intérêt des chercheurs. S’agit-il d’un véritable effet protecteur du tabac lié à un mécanisme biologique ? Ou s’agirait-il d’un biais d’interprétation ?
Pour essayer de répondre à cette question, les interactions entre tabac et génétique viennent d’être étudiées par une équipe constituée autour d’Alexis Elbaz [Note : unité 1018 Inserm/Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines/Université Paris-Sud, Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations, équipe Epidémiologie du vieillissement et des maladies liées à l’âge.]. Selon leurs travaux, deux gènes – RXRA et SLC17A6 – pourraient moduler la relation entre le tabac et la maladie de Parkinson. Parce que les deux protéines codées par ces gènes jouent un rôle dans la neurotransmission, ces travaux soutiennent l’idée d’une protection conférée par le tabac en relation avec un mécanisme biologique sous-jacent. « L’idée n’étant évidemment pas d’inciter les gens à fumer », insiste le chercheur, « mais plutôt d’identifier les molécules qui, dans la fumée du tabac, seraient responsables de cette interaction, ainsi que les mécanismes biologiques impliqués ». Ce qui permettrait éventuellement, à plus long terme, d’envisager des approches de prévention ou même de traitement de la maladie, si ces résultats étaient confirmés.
La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative caractérisée par la destruction progressive des neurones dopaminergiques situés dans la substance noire, une zone du cerveau impliquée dans la motricité. Son apparition reposerait sur des facteurs à la fois génétiques et environnementaux.
Plusieurs gènes ont été identifiés comme pouvant favoriser l’apparition de la maladie mais, pour la plupart, ils ont une faible pénétrance ; en d’autres termes, seule une minorité de porteurs de l’un ou l’autre de ces gènes développe la maladie de Parkinson. En réalité, ces particularités génétiques constitueraient une première marche vers la maladie, mais seule leur interaction avec un ou des facteurs environnementaux – comme l’exposition aux pesticides – les conduiraient à la développer. À l’inverse, les données épidémiologiques qui décrivent moins de malades Parkinson parmi les fumeurs ou ex-fumeurs suggèrent que certaines interactions peuvent être protectrices.
Deux gènes parmi d’autres…
Pour interroger la potentielle interaction du tabac avec les gènes, l’équipe de chercheurs a adopté une approche dénuée d’apriori : elle a choisi de passer en revue 298 gènes impliqués dans la susceptibilité – absorption, transport, dégradation, élimination- aux xénobiotiques (substances étrangères à l’organisme) – afin d’observer si certains d’entre eux étaient distribués de manière différente chez les malades par rapport à des sujets sains, et cela selon leurs habitudes tabagiques – actuels ou anciens fumeurs versus non-fumeurs.
À partir d’une étude française portant sur 513 malades, comparés à 1147 témoins, les analyses génétiques ont mis en exergue 9 polymorphismes nucléotidiques (SNP) impliqués dans une interaction avec le tabac. Deux d’entre eux ont ensuite été confirmés à partir des analyses conduites à partir d’une cohorte américaine regroupant 1 200 sujets malades ou témoins. De façon intéressante, explique Alexis Elbaz, « les gènes porteurs de ces SNP – RXRA et SLC17A6 – codent respectivement pour un récepteur à l’acide rétinoïque impliqué dans le système dopaminergique, et pour un transporteur du glutamate dont la transmission est perturbée dans la maladie ».
« Aujourd’hui, nous devons conduire la même analyse au sein d’une cohorte de patients plus large afin de valider entièrement ces résultats. Ce travail est d’ores et déjà planifié et rassemblera ces prochains mois les données issues de 25 000 patients européens », projette-t-il. « Par ailleurs, nous avons depuis mis en évidence une interaction d’autres gènes avec le tabac ». En effet, en suivant une approche différente, l’équipe a identifié une autre interaction entre le tabac et le gène HLA-DRBA1 dans la maladie de Parkinson. « Ces résultats permettent d’identifier des mécanismes biologiques à étudier : en effet, si ces gènes influencent la relation entre le tabagisme et l’apparition de la maladie, elles constituent autant de pistes à explorer pour décrypter entièrement les mécanismes physiopathologiques initiaux ».
Transmis par Martine Delmond
La parvalbumine, la protéine qui prévient les fibres amyloïdes
Publié le 29 juin 2018 à 12:25Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°73
Le poisson a longtemps été considéré comme un aliment sain, lié à l’amélioration de la santé cognitive à long terme, mais les processus sous-jacents restent mal compris. Les acides gras oméga‑3 et ‑6 sont souvent évoqués comme à l’origine de ces effets cognitifs positifs. Cette recherche invoque aussi le rôle positif de la protéine parvalbumine. Car une caractéristique de la maladie de Parkinson est la formation de fibres amyloïdes par la protéine α‑synucléine. L’alpha-synucléine est même parfois appelée la « protéine de Parkinson ».
Les chercheurs suédois montrent que la parvalbumine peut former des structures amyloïdes à partir de la protéine alpha-synucléine. La parvalbumine « piège » les protéines de l’alpha-synucléine, les utilise « à ses propres fins », les empêchant ainsi de former plus tard leurs propres fibres amyloïdes dangereuses.
La parvalbumine kidnappe la « protéine de Parkinson » et l’empêche de s’agréger, en induisant son regroupement avant la formation de fibres dangereuses, explique l’auteur principal, le Dr Pernilla Wittung-Stafshede, professeur de biologie chimique.
Or la parvalbumine est très abondante dans certaines espèces de poissons : augmenter les apports de poisson dans l’alimentation apparaît donc comme un moyen simple et prometteur de lutter contre la maladie de Parkinson. « Le poisson est normalement beaucoup plus nutritif à la fin de l’été, en raison d’une activité métabolique accrue », expliquent les chercheurs, « les niveaux de parvalbumine sont donc beaucoup plus élevés chez les poissons en automne ».
Le lien entre une consommation accrue de poisson et une meilleure santé à long terme pour le cerveau est établi depuis longtemps. Cette recherche de la Chalmers University of Technology (Suède) en identifie une raison possible, la parvalbumine, une protéine présente en grande quantité dans plusieurs espèces de poissons, qui contribue à prévenir la formation d’alpha-synucléine, une protéine étroitement associée à la maladie de Parkinson.
Lu par Martine Delmond
Expérimentation à Montréal avec le P.o.N.S (Stimulation Neuromodulateur Portable)
Publié le 28 juin 2018 à 09:34Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°73
Helius Medical Technologies Inc. (une société dédiée au bien-être neurologique), a récemment annoncé que l’étude pilote sur la sclérose en plaques (SEP) évaluant le dispositif de stimulation neuromodulateur portable (PoNS ™) de la société répondait à tous les objectifs de l’étude.
Le PoNS est un dispositif non invasif qui permet l’administration de neurostimulation par la langue. Le dispositif est basé sur le concept que la langue peut être utilisée comme une entrée naturelle et directe pour stimuler le cerveau, d’autant plus qu’elle est richement innervée par des milliers de fibres nerveuses et interconnectée par deux nerfs crâniens majeurs au tronc cérébral.
Le système PoNS est actuellement évalué au Canada, à l’Institut et hôpital neurologiques de Montréal et au Centre PERFORM de l’Université Concordia, en tant que thérapie pour les troubles de la démarche et de l’équilibre chez les patients atteints de SP. Au total, 14 participants (dont 7 atteints de SP active et 7 témoins) ont été soumis à cette technologie de stimulation cérébrale non invasive en même temps que la physiothérapie. Les avantages cliniques potentiels de la neurostimulation du PoNS ont été évalués et l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) a été utilisée pour déterminer l’effet du dispositif pendant que les participants effectuaient des tâches de mémoire de travail et d’imagerie mentale, avec ou sans stimulation.
Les résultats de l’IRMf ont révélé que le dispositif PoNS semble faciliter la plasticité neuronale. En effet, après traitement, les patients atteints de SEP présentent une fonction cérébrale similaire à celle des sujets sains. Les patients atteints de SEP ont également connu une amélioration significative de l’équilibre après 14 semaines de traitement. En outre, les chercheurs ont signalé un bon « profil de sécurité » pour la thérapie PoNS.
Les chercheurs de l’Institut et hôpital neurologiques de Montréal sont satisfaits de l’exécution de cette étude et sont enthousiasmés par les résultats qui pointent vers une nouvelle frontière dans la recherche sur la réadaptation des lésions cérébrales. « Nous sommes heureux d’être à l’avant-garde de la recherche qui pourrait apporter cette technologie aux patients dans le besoin », a déclaré le chercheur principal de l’étude, le Dr Gabriel Leonard, dans un communiqué de presse.
« Nous sommes ravis des résultats qui concordent avec les études antérieures. Les données de l’IRMf montrent que le PoNS peut changer la façon dont le cerveau fonctionne » a ajouté le Dr Jonathan Sackier, médecin en chef de Helius.« La mesure de l’activité cérébrale et les changements qui se produisent à travers l’IRMf sont conçus pour déterminer de manière objective si, en fait, il existe des indications de changement neuroplastique dans le cerveau. ».
Cette étude pilote a également permis à l’équipe de recherche d’identifier les facteurs qui doivent être améliorés dans la conception des futurs essais, y compris le recrutement, le dépistage, la randomisation et l’exécution. Les auteurs ont déterminé qu’un échantillon de 128 participants (64 avec MS active et 64 témoins) serait approprié pour une étude définitive d’essai clinique sur la SEP.
« C’est un développement passionnant et prometteur pour notre entreprise, nos patients et la communauté médicale. La prise en charge des symptômes causés par la SEP a été un défi pour la communauté médicale et nous sommes ravis de poursuivre PoNS en tant qu’outil thérapeutique potentiel » a déclaré le PDG d’Helius, Philippe Deschamps. « Nous avons atteint tous les objectifs de cette étude et sommes optimistes car nous continuons à faire progresser le dispositif PoNS à travers des essais cliniques ».
Les résultats de l’étude seront soumis pour publication dans un proche avenir. Aux États-Unis, le dispositif PoNS est actuellement testé pour le traitement du trouble de l’équilibre chez les patients présentant une lésion cérébrale traumatique légère à modérée. Helius prévoit de classer l’appareil pour l’autorisation de la Food and Drug Administration américaine.
Posté sur le web le 16 janvier 2018
Lu par Michel David
Le dispositif portatif de stimulateur de neuromodulation (PoNS®)
Publié le 27 juin 2018 à 14:53Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°73
Alors que les médecins et les patients se tournent vers les options disponibles pour gérer une foule de symptômes neurologiques aujourd’hui, les options limitées aident réellement à réhabiliter les fonctions perdues pour les millions de personnes vivant avec des troubles chroniques. Le dispositif PoNS est étudié comme une nouvelle option potentielle pour le traitement des symptômes neurologiques chroniques de maladie ou de traumatisme.

Cette nouvelle façon d’appliquer le concept de neuroplasticité à la réadaptation est l’invention de scientifiques du laboratoire de communication tactile et de neuro réhabilitation de l’Université du Wisconsin-Madison (TCNL).
Théorie scientifique : Amplifier la capacité du cerveau à se guérir. Le dispositif PoNS est basé sur près de 40 années de recherche dans le domaine de la neuromodulation : l’utilisation de la stimulation externe pour modifier et réguler intentionnellement l’environnement électrochimique du cerveau. On croit que la neuromodulation améliore la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se restructurer ou à réapprendre en réponse à de nouvelles expériences, à des apports sensoriels et à des exigences fonctionnelles. La recherche a montré que le processus de neuroplasticité sous-tend tout l’apprentissage cérébral, l’entraînement et la réadaptation.

Dans les études cliniques, le dispositif PoNS couplé à une thérapie fonctionnelle ciblée (ensemble PoNS® Treatment) induit une neuroplasticité. La thérapie consiste en des exercices physiques, professionnels et cognitifs ciblés, basés sur les déficits du patient.
La recherche montre que la stimulation électrique de la langue (neurostimulation translingual — TLNS) stimule deux nerfs crâniens majeurs : le trijumeau (le nerf responsable des sensations dans le visage, mordant et mâchant) et le facial (le nerf responsable du contrôle moteur de la plupart des muscles de l’expression faciale). La stimulation électrique des nerfs crâniens crée un flux d’impulsions neurales qui sont ensuite transmises directement dans le tronc cérébral – le principal centre de contrôle de nombreuses fonctions de la vie, y compris la perception sensorielle et le mouvement. À partir du tronc cérébral, ces impulsions voyagent à travers le cerveau et activent ou réactivent les neurones et les structures impliqués dans la fonction humaine – le cortex, la moelle épinière et potentiellement tout le système nerveux central.
Le dispositif PoNS
Cinq établissements aux États-Unis et au Canada (dont le Neuro l’Institut et Hôpital Neurologique de Montréal), depuis quelques années, mettent à l’essai un dispositif expérimental prometteur appelé « stimulateur portable de neuromodulation » ou PoNSMC, fabriqué par Helius et conçu pour le traitement des lésions causées par les commotions cérébrales. Le nom de ce dispositif rappelle le terme anglais Pons, qui désigne la protubérance annulaire – structure très importante située dans la partie supérieure du tronc cérébral. Cette structure cérébrale participe au contrôle de la respiration, de l’ouïe, du goût et de l’équilibre, et facilite également la communication entre les différentes parties du cerveau. Tenu dans la bouche, le dispositif émet une légère stimulation électrique qui se rend au cerveau en empruntant les nerfs de la langue ; pendant ce traitement, le patient fait des exercices de physiothérapie.« La langue est un organe très sensible. Lorsqu’elle reçoit des stimuli électriques, l’information est envoyée au tronc cérébral, particulièrement au niveau de la protubérance annulaire », explique le Pr Ptito. « L’information est ensuite distribuée dans l’ensemble du cerveau. Nous croyons qu’en stimulant la langue, nous pouvons du même coup stimuler la plasticité cérébrale dans l’espoir de régler certains problèmes associés aux lésions cérébrales, comme les pertes d’équilibre. »
Ce dispositif est également mis à l’essai auprès de patients atteints de la maladie de Parkinson ou de sclérose en plaques et qui présentent des troubles de l’équilibre.
Les chercheurs croient que cette stimulation soutenue initie une cascade séquentielle de changements dans les noyaux réels interconnectés, ou le réseau neuronal, qui sont au cœur des principales composantes anatomiques du cerveau.
Sur la base de cette théorie, on pense que la neuromodulation induite par le dispositif PoNS, combinée à une thérapie fonctionnelle, peut être appliquée pour améliorer une grande variété de symptômes neurologiques.
Mise à jour PoNS, janvier 2018 :
Les informations sur la disponibilité du PoNS seront désormais transmises par le fabricant de l’appareil, http://heliusmedical.com/. En bref, une bonne nouvelle : les patients finaux dans les études requises pour l’approbation de la FDA ont terminé leur traitement en mai et juillet 2017. Les deux études qui sont les conditions préalables à l’approbation de la FDA sont maintenant terminées et un package final avec les résultats, est actuellement en cours de préparation par Helius pour soumission à la FDA. Mais le PoNS ne peut pas être mis à la disposition du public avant l’approbation de la FDA. Aux dernières nouvelles, cela pourrait prendre jusqu’à la fin de 2018 pour que la FDA rende sa décision.
Cela peut sembler déroutant puisque le PoNS était disponible pour les patients qui participaient aux études bien connues (par exemple, l’étude militaire américaine sur son utilisation pour traiter les lésions cérébrales traumatiques et l’étude du Montréal Neurological Institute pour les patients atteints de sclérose en plaques). Mais maintenant que les études sont complètes, le PoNS ne peut être accessible à quiconque avant qu’il ne soit approuvé par la FDA.
Nous savons que cela est frustrant pour ceux qui espèrent avoir accès à un système PoNS, et qui espéraient qu’il serait disponible dès maintenant, mais ce délai n’est pas, hélas, inhabituel dans l’approbation de nouveaux dispositifs de pointe.
D’autres nouvelles indiquent qu’il y a une migration de l’activité de développement PoNS vers Helius. Les études PoNS ont été complétées mais le Laboratoire de Communication et Neurorehabilitation Tactile (TCNL) qui a ouvert en 1992 et développé le PoNS et de nombreuses autres inventions, vint d’être fermé et les trois scientifiques qui ont inventé le PoNS – Yuri Danilov, Kurt Kaczmarek PhD et Mitch Tyler PhD – conseillent maintenant Helius sur la façon de l’affiner : 50 dossiers sont présents sur le
site : http://heliusmedical.com/
Lu par Michel David
Parkinson et boulimie
Publié le 26 juin 2018 à 10:52Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°73
Les chercheurs de la Scuola Internazionale Superiore de Studi Avanzati (SISSA Trieste) rappellent que l’hyperphagie boulimique est un problème qui touche fréquemment les patients parkinsoniens. Ils identifient avec ces travaux, présentés dans la revue Parkinsonism and Related Disorders, deux explications possibles : une altération de la mémoire de travail et une altération de la sensibilité à la récompense.
La frénésie alimentaire qui affecte de nombreux patients parkinsoniens est un effet secondaire des médicaments dopaminergiques, expliquent tout d’abord les auteurs : « dans la littérature, les troubles du contrôle des impulsions, tels que l’hypersexualité ou l’addiction au jeu, ont également souvent été décrits comme associés à la maladie de Parkinson, en raison d’une altération de la mémoire de travail et de la sensibilité aux récompenses. La frénésie alimentaire est un comportement qui résulte aussi de l’absence de contrôle d’une impulsion par une pensée plus profonde permettant de maintenir un comportement alimentaire « normal » et plus sain ». L’équipe de Trieste montre que cette absence de contrôle chez certains patients parkinsoniens pourrait être associée à une atteinte de la mémoire de travail. Ce déficit amènerait les patients à se « gaver », ce qui leur permettrait de se préserver de garder en mémoire l’objectif à long terme d’un comportement alimentaire « sain ». Autre dysfonctionnement évoqué par l’étude, un dérèglement de la sensibilité à la récompense et à ses composantes, à savoir le plaisir (lié à la consommation de nourriture) et le désir (le désir d’obtenir de la nourriture).
Le système de récompense est déficient et l’altération de la mémoire de travail inhibe toute volonté : les chercheurs commencent par analyser la sensibilité à la récompense pour comprendre si et comment ce système est altéré chez les patients atteints de Parkinson souffrant d’hyperphagie boulimique. La sensibilité aux récompenses comprend 2 composantes, «
Pour mesurer le premier élément, « le plaisir », les auteurs ont invité les participants à effectuer une « tâche d’amorçage affectif », dans laquelle ils devaient classer un stimulus positif ou négatif précédé par des aliments présentés de façon subliminale. Lorsque la nourriture possède une valeur positive pour le participant, celui-ci devrait être plus rapide à classer les stimuli positifs et vice versa si la nourriture possède une valeur négative.
Pour évaluer la deuxième composante, « le désir »», les auteurs ont présenté des images d’aliments et ont demandé aux participants à quel point ils en avaient envie, en exerçant une pression sur un dynamomètre à poignée. Dans cette tâche, l’effort exercé est directement associé à sa motivation pour la récompense. Ces 2 expériences montrent que les patients atteints de Parkinson et de boulimie, donnent une valeur négative aux aliments sucrés par rapport aux participants non affectés par la maladie, probablement parce que cette catégorie d’aliments est très problématique pour eux. Les participants boulimiques présentent un déficit de mémoire de travail. Or, la mémoire de travail est la fonction cognitive qui permet de garder l’information à l’esprit pendant que nous accomplissons une tâche. Chez les patients atteints de Parkinson souffrant de boulimie, le déficit de mémoire de travail leur permet d’éviter de penser aux effets possibles de leur comportement. L’étude apporte ainsi des indications sur les mécanismes qui sont altérés : le mécanisme de récompense ou le « plaisir » est perçu comme problématique et l’altération de la mémoire de travail qui inhibe toute volonté. D’autres études doivent encore confirmer ces explications, en particulier pour pouvoir mieux gérer ce comportement alimentaire ‑comme d’autres addictions- qui affecte non seulement fortement la qualité de vie des patients, mais les expose également à de graves problèmes de santé.
05/05/2018 PARKINSON et BOULIMIE, pourquoi ? | santé log
https://www.santelog.com/actualites/parkinson-et-boulimie-pourquoi 3/9
[vu sur le net] Danser contre la maladie de Parkinson
Publié le 16 juin 2018 à 12:03article trouvé sur le site du Figaro santé
Une scène a été dressée dans l’un des halls d’exposition du Museo Civico de Bassano del Grappa, près de Vicence, en Italie, à l’occasion de l’exposition d’un artiste italien, Daniele Marcon, intitulée In-colore. Des gens dansent sur la scène. La plupart d’entre eux souffrent de la maladie de Parkinson. Ils sont invités à s’inspirer de tableaux aux motifs géométriques, carrés et rectangles, principalement de couleurs sombres, aux contrastes nets et aux lignes bien définies. Leur but est de stimuler la réponse émotionnelle du public, précisément parce que les couleurs fortes peuvent transmettre le flux énergétique de la vie.
Pour lire cet article dans son intégralité, suivez ce lien …
Propulsé par WordPress et le thème GimpStyle créé par Horacio Bella. Traduction (niss.fr).
Flux RSS des Articles et des commentaires.
Valide XHTML et CSS.