Le « coup de gueule » de Martine Belmond
Publié le 27 juillet 2018 à 08:06Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°73
Le « dioxyde de titane » est utilisé pour blanchir des aliments, des confiseries ou des médicaments. Ce produit, appelé aussi E171, présenterait un risque cancérigène.
A l’origine, il s’agit d’un minerai présent dans la nature : on l’utilise dans les montres, les ordinateurs, les avions pour sa résistance à l’érosion.
Pour transformer ce minerai en poudre, on verse de l’acide, puis il est broyé en particules très fines, invisibles à l’œil nu : des nanoparticules…
Une étude publiée en janvier 2017 par l’Institut national de la recherche agronomique avait mis en évidence la nocivité de l’E171. « Menée sur des rats, elle démontrait que l’absorption de cette substance représente un danger pour les êtres vivants. Une fois ingéré, le dioxyde de titane passe au travers de la paroi de l’intestin pour finir par se retrouver dans l’organisme, entraînant des troubles du système immunitaire. Une exposition régulière à ce produit induit l’apparition de lésions précancéreuses pour le rongeur. »
Cet additif se présente sous la forme d’une poudre composée de nanoparticules, employée pour blanchir et nacrer des dentifrices, des crèmes cosmétiques ou encore, des confiseries et de nombreux aliments préparés.
Cet additif est partout, même là où on ne le soupçonnerait pas… et même dans des médicaments qui sont normalement faits pour soigner. Comment les laboratoires peuvent-ils utiliser des produits toxiques pour fabriquer des médicaments ?
Où est la cohérence ? A moins que les laboratoires soucieux de leurs chiffres d’affaires ne veuillent générer de nouvelles maladies afin d’engranger toujours plus de profits ! Une stratégie machiavélique dans un monde où l’argent est roi, dans un monde où on fait fi de la santé des gens…
Que deviennent l’éthique, la morale quand des labos créent des médicaments remplis d’additifs délétères ? Et que penser des industriels de l’agro-alimentaire qui intègrent des produits nocifs dans des confiseries pour enfants ? Sont ainsi impactés des organismes particulièrement fragiles : des enfants, des malades.
Les labos devraient recevoir injonction de fabriquer des médicaments sans polluants… Mais les industriels se soucient fort peu de la santé des consommateurs, et ce, dans de nombreux domaines. Certains médicaments sont ainsi vendus fort cher, alors même qu’ils contiennent des substances nocives : colorants et additifs chimiques. Seuls les colorants naturels devraient être autorisés…
Rédigée par Martine Delmond
É N E R V A N T
Publié le 25 juillet 2018 à 13:28Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°73
ÉNERVANT, c’est le seul mot qui me vient à l’esprit quand je pense à ma maladie : la maladie de Parkinson.
ÉNERVANT, de ne savoir quoi répondre quand on me demande « Comment tu vas ? » surtout si la question est « tu as l’air d’aller mieux ? » en effet la sensation de bien-être est tellement fluctuante.
ÉNERVANT, d’avoir plus de difficulté à s’habiller qu’à déplacer de lourdes charges. ÉNERVANT, quand on me propose de m’aider dans des actions demandant un effort physique, mais que l’on me laisse faire des tâches simples qui représentent pour moi de bien plus de difficultés.
ÉNERVANT, les conseils : « n’oublie pas tes médicaments, mange correctement, couche-toi plus tôt, ½h pour les mouvements du matin, ½h pour la marche, ½h pour l’entraînement à l’écriture, etc. »
ET QUAND est-ce que je fais ce qui me plait ? Voir des amis, bricoler, faire le jardin, etc.
ÉNERVANT, quand je dis quelque chose et que la personne ne répond pas car elle ne s’est même pas aperçue que je parlais et quand elle le voit, énervant de répéter car elle n’a rien entendu.
ÉNERVANT, que toutes les petites misères liées à la maladie (problèmes de vue, fausses routes, problèmes urinaires, crampes, etc.) ne semblent pas acceptées comme telles par l’entourage qui pense que ce n’est pas lié à la maladie mais plutôt à l’âge !!!!
ÉNERVANT, de ne pouvoir se retourner dans le lit.
ÉNERVANT, d’avoir des difficultés à mettre des chaussettes.
ÉNERVANT, d’avoir du mal à écrire un chèque.
ÉNERVANT, d’avoir des somnolences en journée dès que je ne suis plus occupée et de ne pas avoir envie de se coucher de la nuit.
ÉNERVANT, de ne plus pouvoir faire deux choses en même temps, de démarrer une tache en oubliant celle que j’ai en cours dans l’autre pièce.
ÉNERVANT, de ne plus avoir cette grande capacité de concentration que j’avais auparavant.
ÉNERVANT, cette émotivité constante qui amène les larmes aux yeux sans raison. Je ne peux plus raconter des anecdotes sans les simplifier, si bien que mon discours devient inconsistant.
Et pourtant, j’ai une chance inouïe par rapport à d’autres parkinsoniens :
- J’ai des médecins (généraliste et neurologue) formidables qui ont détecté la maladie en deux mois, et j’ai eu la prise en charge (ADL) en trois mois.
- J’ai une kiné et une orthophoniste qui connaissent bien la maladie, elles m’aident beaucoup et m’entourent de sympathie.
- Pour l’instant, ma maladie ne se voit pas trop. Je reste indépendante et elle ne me perturbe pas trop dans mes activités.
- Personne, ni dans la famille, ni parmi les amis ne m’a fait faux bond et à part une ou deux personnes, ils continuent de voir « Bernadette » et pas « une malade ». Tous restent discrets sur mes « somnolences » à table, même au restaurant.
- En plus, à travers les associations, cette maladie m’a donné une occupation toute trouvée pour la retraite et… beaucoup d’amis!!!
Mais malgré tout, qu’est que c’est ÉNERVANT!!!
Bernadette, février 2013
Transmis par Hélène Le Dref
Les chaussures minimalistes ou « chaussures à orteils »
Publié le 23 juillet 2018 à 03:06Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°73
Souffrant de « crampes du pied » (dystonie : les orteils qui se recroquevillent dans la douleur, les personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson connaissent…) qui peuvent survenir n’importe quand lors de la marche, mais de préférence en randonnée, j’en étais réduite à ne plus me promener seule en forêt et à écourter mes balades : avec la hantise de la crampe, cela n’avait plus grand-chose de réjouissant… Mais il ne faut pas s’avouer vaincu… C’est en réalisant que pieds nus ou en sandales légères j’avais moins de crampes et qu’en tous cas j’arrivais plus facilement à remettre en place les orteils – et donc à faire passer la crampe, que j’ai pensé aux chaussures minimalistes.

Elles ne sont pas très connues mais vous en avez peut-être déjà vu, ce sont des chaussures qui évoquent des gants de pieds, elles interfèrent le moins possible avec les mouvements naturels du pied. On a ainsi les sensations de la marche – ou de la course pour les sportifs – pieds nus, sans leurs inconvénients grâce à une semelle très fine étudiée pour amortir les chocs… J’en avais déjà entendu parler à propos de course à pied, un milieu où elles commencent à être très appréciées, mais c’est un article de la revue Alternatif Bien-Être (n°126, mars 2017) qui m’a convaincue d’en acheter une paire : avec des orteils bien séparés, déjà me serait-il plus facile de lutter contre les crampes ?
« Quand on est sujet aux « crampes de pied », se chausser devient un problème, qui s’ajoute aux difficultés parkinsoniennes pour trouver la bonne position pour s’asseoir, se baisser, enfiler la chaussure, faire les lacets etc.
L’article d’Alternatif Bien-Être présente les bienfaits que procureraient les chaussures minimalistes d’après quelques études en anglais et des témoignages d’usagers :
« Développement de votre équilibre et de votre proprioception : grâce à la flexibilité et à la fine épaisseur de sa semelle, le pied est beaucoup plus proche du sol, les récepteurs proprioceptifs captent pleinement la pression exercée sur la voûte plantaire. Ainsi, en marchant avec des chaussures minimalistes, vous stimulez votre système vestibulaire (le système de l’équilibre). Un système vestibulaire réactif est capital pour prévenir le risque de chute ou de blessure. (…)
Travail de votre mobilité : dans une chaussure minimaliste, les doigts de pieds sont nettement moins compressés que dans une chaussure maximaliste. Le gros orteil, par exemple, a besoin d’espace et de flexibilité pour pouvoir pleinement vous aider lors des changements de direction et dans le maintien de l’équilibre.
Stimulation de la neurogénèse : une étude intéressante parue dans le journal Médical Hypothèses en 2016 suggère que marcher avec des chaussures plates stimulerait notre neurogénèse, c’est-à-dire le renouvellement et la croissance de nos neurones au fil du temps, et entraînerait une diminution des maladies du système nerveux telle la démence sénile. En effet, la suppression de l’épaisseur du talon et la fine épaisseur de la semelle permettent au pied de se poser horizontalement sur le sol. Du coup, les récepteurs de la voûte plantaire peuvent fournir une meilleure cartographie au système nerveux. Ce dernier est donc sollicité plus largement, ce qui stimule sa croissance et ses performances.
Réduction de l’arthrose : une étude publiée dans Arthritis & Rheumatism démontre que marcher pieds nus et la marche minimaliste réduiraient de façon significative la pression exercée sur les genoux par rapport à des chaussures conventionnelles. Dans cette étude, les résultats ont démontré une réduction de 18 % de la force imputée aux genoux ainsi qu’une réduction de la douleur de 36 %.
Meilleure circulation du sang : comprimer son pied et l’enfermer dans une chaussure conventionnelle serait nettement plus néfaste pour la circulation sanguine. La marche minimaliste diminue la viscosité du sang et participe à la prévention des varices et des maladies cardiaques
Meilleure posture : un talon épais avec amorti modifie notre posture naturelle et entraîne bien souvent des compensations d’ordre postural. Nous sommes contraints de nous pencher vers l’avant, forçant nos hanches et le bas de notre dos à compenser comme ils peuvent. En prenant l’habitude de marcher pieds nus ou en chaussures minimalistes, les terminaisons nerveuses de notre voûte plantaire peuvent nous renseigner sur la position de notre corps.
De nombreux marcheurs minimalistes témoignent d’une amélioration de leur posture ainsi que d’une diminution progressive des douleurs de genou, de hanche et de dos. La randonnée ou marche nordique agissent déjà positivement sur la pression artérielle, la fréquence cardiaque au repos, le renforcement des os et la prévention de l’ostéoporose, l’entretien des articulations. Elles libèrent des endorphines qui diminuent le stress et stimulent votre métabolisme. En somme, déjà de nombreux atouts santé. La science d’aujourd’hui démontre de plus en plus que la marche minimaliste serait encore plus bénéfique pour la santé globale, alors pourquoi ne pas s’y mettre ? Si cette pratique vous tente, je vous recommande une phase transitoire où vous pouvez alterner des chaussures conventionnelles et des chaussures minimalistes à chaque sortie pour laisser le temps à vos pieds de s’adapter. »
Vous pouvez vous tourner vers des marques comme Vivobare-foot, Vibram Fivefingers, Merrell ou encore Inov8 qui proposent des chaussures minimalistes pour la marche comme pour la course à pied à des prix allant de 70 à 230 euros. Le mieux est d’essayer en boutique spécialisée ou, à défaut. N’ayant trouvé aucune boutique spécialisée, j’ai acheté mes chaussures sur internet, la plupart des sites proposent le retour gratuit si ça ne va pas. J’ai choisi un des modèles les moins chers et les plus légers (peur de ne pas arriver à enfiler les modèles « treck » par ex.), Alitza Loop de Vibram five fingers.
On les porte sans chaussettes, ça n’est pas gênant. Sinon il existe des chaussettes « à orteils », mais dans ce cas il vaut mieux prévoir une pointure de plus car ces chaussures taillent un peu serrées. On peut aussi commencer par acheter juste des chaussettes à orteils (sur internet, à partir de moins de 10 euros) et les porter juste dans la maison pour habituer les pieds à avoir les orteils bien séparés.

J’ai été agréablement surprise à la réception, pas eu besoin d’échanger : j’ai les orteils qui sont plutôt serrés et biscornus mais ils ont tous facilement trouvé leur compartiment. Je pensais galérer pour enfiler ces chaussures, pas de difficulté si je suis bien installée, et cela me prend beaucoup moins de temps que pour mes chaussures fermées, avec lesquelles j’ai des crampes à tous les coups.
Je croise les doigts –de mains ! – , justement, des crampes depuis une semaine avec mes chaussures minimalistes, je n’en ai toujours pas eu ! Je revis !! Je n’ai pas encore testé sur de grandes balades d’une heure ou plus, juste des petites marches en forêt. Ces chaussures sont plus légères que des ballerines. Les semelles amortissent bien les chocs, la sensation de marche est très agréable, spontanément je me tiens mieux, je marche plus vite aussi, le moral s’en ressent… Au repos, mes orteils sont plus détendus, et moins serrés, je n’arrive pas encore à avoir les doigts de pied en éventail mais ça s’en approche. Je ne suis pas la seule à trouver mes chaussures jolies, elles attirent l’attention. À suivre, je reviendrai compléter cet article plus tard.
Mireille Saimpaul (Parkinette)
Vous avez dit « aidants » ?
Publié le 16 juillet 2018 à 08:56Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°73
Acteurs éminents, indispensables dans la prise en charge de la perte d’autonomie, ils sont un complément nécessaire aux personnels de l’aide à domicile. Qui sont –ils ? L’aidant familial est la personne qui vient en aide à titre non professionnel, en partie ou totalement à une personne âgée dépendante ou à une personne handicapée de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne. Elle peut prendre différentes formes comme le nursing les soins, l’accompagnement à la vie sociale, les démarches administratives, la coordination, la vigilance, le soutien psychologique, les activités domestiques.
État des lieux
On estime en 2008 (derniers chiffres publics) à 8,3 millions les aidants familiaux d’une personne âgée, en situation de handicap, souffrant d’une maladie chronique lourde, eux-mêmes âgés de 16 ans et plus. Les femmes représentent 57% des aidants, 47% des aidants occupent un emploi. La famille proche est au cœur de l’aide apportée : 62% sont les conjoints, 13% sont les enfants quand ils vivent ensemble.
Comment expliquer ce phénomène ?
Réticence à recourir à une personne tierce pour des soins personnels, soutien moral plus facile, question financière, ignorance des droits. Cependant, les configurations d’aide mixte, articulant aidants et professionnels sont les plus courantes.
Les impacts négatifs sur les différents aspects de la vie des aidants sont nombreux. La charge ressentie se traduit par des effets physiques, psychologiques, émotionnels, sociaux et financiers. Elle est plus importante chez les femmes, 20% des aidants ressentent une fatigue morale ou physique importante. Les vies personnelle, familiale et sociale sont les plus affectées. Enfin l’impact sur la santé est important.
Le droit au repos : où trouver les informations ?
Code de l’action sociale et des familles : articles l232‑3 – 2, D2326961 ? R232-27 (Droit au Répit)
Code du travail : articles L3142-16 à 27, D3142‑7 à 13 (droit au congé du proche aidant)
https://www.pour-les-personnes-agées.gouv.fr/.
Diverses rubriques renseignent sur : vivre à domicile, vivre ailleurs temporairement, choisir un hébergement, bénéficier d’aides, exercer ces droits, aider un proche, à qui s’adresser…
Transmis par Nicole Lecouvey
[vu sur le net] — Vers un fond d’indemnisation des victimes de pesticides ?
Publié le 13 juillet 2018 à 14:09article trouvé sur le site Santé Magazine
La question de l’indemnisation des victimes de pesticides reste délicate à régler. En février 2018, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, avait jugé « prématurée » la création d’un fonds spécial abondé par les fabricants de produits phytosanitaires. L’Assemblée nationale avait alors refusé de l’inscrire à son programme.
Mais le Sénat en a jugé autrement. Le 2 juillet dernier, les sénateurs ont réintroduit un article dans le projet de loi sur l’agriculture et l’alimentation, projet qui doit prochainement repasser devant les députés.
Hier, 10 juillet 2018, l’association Alerte des médecins sur les pesticides (AMLP) s’est réjoui dans un communiqué de voir l’idée revenir sur le devant de la scène. L’AMLP réclame, néanmoins, certaines garanties.
Pour lire cet article dans son intégralité, suivez ce lien …
Le monde des « aidants », réflexions sur les « aidants naturels »
Publié le 11 juillet 2018 à 10:36Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°73
L’« aidant » est depuis peu juridiquement qualifié. Il est « aidant familial » ou « aidant naturel ». Et la plupart du temps l’aidant est une aidante, ce que d’aucuns trouvent « naturel ».
Michel Billé va plus loin (il est sociologue, président de l’union nationale des instances et offices de retraités et personnes âgées, membre du conseil scientifique des sciences humaines France Alzheimer).
Quel regard porte-t-il sur le monde des aidants ?
Que l’on observe les choses d’un point de vue franco-français, européen et même mondial, la tendance au vieillissement de la population est partout confirmée. On prévoit pour 2025 une population de 12 milliards de « vieux » soit deux fois plus qu’en 2000. Cette réalité démographique nous conduit à reconsidérer notre système de santé, les besoins, les coûts, les performances et les acteurs.
Pourtant, dans la prise en compte du système de santé, l’apport de millions de « soignants » demeure presque toujours ignoré. Ces méconnus du système s’appellent aidants naturels, aidants familiaux, aidants de proximité. Ils prennent soin d’un malade, d’un parent, d’un conjoint, tantôt à leur domicile, tantôt au domicile de la personne aidée.
« Sans doute serait-il plus juste de parler d’aidant « culturel », tant c’est bien un contexte, des modes de vie qui déterminent cette situation. »
Qui sont ces « aidants naturels ? »
Les aidants sont souvent des aidantes. Au fur et à mesure que la population avance en âge et que se transforment les rapports entre générations, la situation des « aidants naturels » retient davantage l’attention, c’est évidemment légitime.
Il faut pourtant s’interroger sur ce que cette situation a de « naturel ».
En effet, les aidants sont des aidantes, chacun le sait, et le recours ici à la « nature » semble remplir une fonction de masque C’est évidemment la culture qui attribue les rôles que nous avons à jouer, désigne les acteurs et, à travers cela, assigne à chacun une place dans le tissu social.
C’est la culture qui attribue aux femmes, épouses, compagnes, filles, belles-filles et petites filles, les fonctions d’éducation des enfants, des soins aux malades, l’aide aux handicapés et maintenant d’aides aux personnes âgées. Ce qui est vrai à domicile l’est aussi en établissement, c’est aussi cette femme qui y assure de manière bénévole la présence familiale, par exemple par sa participation au conseil de vie sociale. C’est un rôle assigné, attribué, qu’elles endossent sans l’avoir choisi, ce qui ne veut pas dire qu’elles le refusent, ni même qu’elles le subissent. Mais est-ce inné de savoir aider ?
Que cache cette fonction de masque ?
Elle construit, sans le dire, une obligation morale adossée à la notion de loyauté familiale. Elle désigne ceux qui sont concernés dans une sorte de périmètre limité, dit de proximité et place hors du champ professionnel, et par conséquent hors des échanges rétribués, l’action des aidants naturels.
On comprend ainsi que la valorisation de l’aide apportée par les proches passe par la reconnaissance de leur engagement, de leur désintéressement et de leur loyauté dans la relation à leurs ascendants. Sans cette reconnaissance, c’est l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes qui se trouve atteinte. Il ne faudrait pas qu’un recours spontané mais abusif à la « nature » leur inflige un surcroît de culpabilité quand, pour quelque raison que ce soit, ils ne peuvent assumer… ce rôle culturellement assigné.
Propos recueilli dans un magazine « pour retraités »
Par Nicole Lecouvey
Demain, éviter la maladie ?
Publié le 10 juillet 2018 à 07:26Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°73
Qui est à risque ? Et qui est responsable ?
S’il est urgent de soulager ceux qui souffrent de la maladie, s’agissant d’en réduire l’impact – on estime qu’il aura doublé d’ici 2030 – la première des questions à élucider n’est-elle pas d’en connaître les raisons : Où ? Quand ? Dans quelles circonstances elle se manifeste ? Il devient alors possible de dégager des pistes de recherche, ou à défaut, d’énoncer des principes de précaution, comme pour l’amiante… Mais en même temps, ces questionnements conduisent immanquablement à poser la question plus délicate des responsabilités… et par voie de conséquences des victimes.
Le dilemme agricole
Aujourd’hui, des débuts de réponses à ces questions se font entendre parmi lesquelles l’agriculture et ses produits miracles (herbicides, pesticides…) qui ont le pouvoir d’éliminer l’indésirable pour faire place au meilleur… mais aussi l’agriculture et ses agriculteurs devenus malades au nom du même miracle.
L’agriculture et ses agriculteurs se retrouvent alors confrontés au choix crucial suivant entre : Soit s’en remettre au bon sens qui recommande la prudence en ne cédant pas au miracle, avec l’avantage d’échapper à l’exposition aux produits soupçonnés, mais aussi l’inconvénient d’être économiquement à contrecourant … Ou bien céder à la pression des tout puissants lobbies (MONSANTOS, BAYER,…) qui suggèrent avec force la voie facile avec l’avantage du résultat, mais aussi l’inconvénient du risque d’être malade…
Drôle de dilemme face auquel l’agriculteur n’est malheureusement pas en mesure d’exercer son libre arbitre, faute d’être complètement et honnêtement informé sur les décisions et leurs conséquences parmi lesquelles celles à plus long terme sur l’environnement ?
La question environnementale.
Car, aujourd’hui les termes de l’enjeu changent. Nous savons que le risque dépasse largement celui de la population des agriculteurs, atteignant aussi les habitants non agriculteur des régions agricoles. Des études territoriales montrent que nous risquons tous d’être atteints par ces produits qui habitent jusqu’au moindre de nos cheveux, et qu’il existe une relation entre la prévalence de la maladie et l’utilisation faite des produits soupçonnés. Cet élargissement a pour effet de « diluer » les responsabilités et vient compliquer la mise en place de principes de précautions.
Seul, que peut-il ?
Mais même avec les meilleurs arguments, que peut aujourd’hui cet agriculteur victime ? Esseulé, lâché par ceux de sa profession qui, rendement oblige, continuent de croire au miracle… Bien qu’ayant remporté une première victoire pour obtenir le statut de maladie professionnelle, que peut-il face aux puissants lobbies de l’agriculture pour que son combat soit reconnu à l’échelle environnementale ? Prêts à tout pour déstabiliser ceux qui s’aventurent sur la voie juridique, ils nient les évidences avec une insolence incroyable, allant jusqu’à mettre en doute l’intégrité mentale de leurs opposants en prétextant la maladie…
Et nous, qu’y pouvons-nous ?
Nos causes n’ont-elles pas vocation à se rencontrer ? Associations de patient, nous sommes aussi des associations de possibles victimes. A ce titre, nous sommes naturellement désignés pour appuyer les associations de défense de l’environnement par des actions d’information, des témoignages contribuant ainsi à « faire la preuve par les victimes » du caractère neurotoxique des produits incriminés.
A défaut de guérison, évitons la maladie chaque fois que c’est possible. Stop à l’empoisonnement de nos campagnes et de leurs habitants. Non seulement nous sommes tous concernés, mais il y va aussi de la santé des générations futures.
A votre avis?…
Sources :
Les pesticides une nouvelle fois mis en cause dans la maladie de Parkinson
Paul François, l’agriculteur qui a fait condamner Monsanto
Rédigé par Yves Gicquel
Publié le 08 juillet 2018 à 09:16
Deux articles parus dans Presse-Océan du 11/04/2018 à l’occasion de la Journée Mondiale Parkinson
1 — Parkinson, une « maladie de vieux » ?
Non, 17% des nouveaux cas ont moins de 65 ans.
Les tremblements, unique symptôme ? Loin de là, ils ne sont pas systématiques. Bien que répandue, cette maladie fait toujours l’objet d’idées reçues. « Parkinson est bien plus complexe que simplement sucrer des fraises » explique Jean-Louis Dufloux lors d’une conférence de presse de l’Institut du Cerveau et de la moelle épinière (ICM) à l’occasion de cette Journée Mondiale.
Âgé de 57 ans, il est atteint de Parkinson et a écrit un livre Cinquante et un pour montrer avec humour qu’il ne s’agit pas « d’une maladie de vieux ». « Les symptômes, ce sont la maladresse, le dérèglement du sommeil : on dort peu, on se lève très tôt, on a des moments de somnolence » détaille-t-il « il y a aussi des sens interdits : on perd l’odorat. On a des moments de dépression, qui se déclenchent sans comprendre. Et la maladie fige les expressions du visage… Cela permet de gagner au poker ! » glisse-t-il dans un sourire.
Parkinson est une maladie neurodégénérative, la deuxième en termes de fréquence, derrière Alzheimer. Au fil de son évolution, le risque de dépendance augmente pour les malades, en raison de complications motrices et cognitives, qui peuvent aller jusqu’à la démence. Elle touche 166.000 personnes en France, soit 2,5 pour 1.000, avec environ 25.000 nouveaux cas par an, selon les derniers chiffres dévoilés en avril 2018 dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) de l’Agence Sanitaire Santé Publique France : 17% des nouveaux cas sont âgés de moins de 65 ans. « Dans un cas sur deux, la maladie débute avant 58 ans, en pleine vie active », souligne Le Professeur Damier, neurologue au CHU de Nantes. En 2030 on estime que 260.000 personnes seront traitées pour la Maladie de Parkinson en France, soit 1 personne sur 120 parmi les plus de 45 ans. « Cela représente une augmentation de 56% par rapport à 2015″ note le BEH.
Les traitements actuels agissent sur les symptômes mais ne guérissent pas la maladie.
2 — Pesticides : Les Riverains sont aussi touchés.
Le risque de Maladie de Parkinson lié aux pesticides ne se limiterait pas aux seuls agriculteurs, mais toucherait aussi la population des régions agricoles, et notamment les viticoles, plus exposées à ces substances, selon une étude publiée en avril 2018.
Une augmentation de la Maladie de Parkinson dans la population générale habitant les cantons français les plus agricoles a en effet été relevée dans une étude épidémiologique nationale. Cette augmentation est observée « y compris après exclusions des agriculteurs » souligne l’éditorial du Bulletin Epidémiologique hebdomadaire (BEH) dédié à la Maladie de Parkinson.
Une explication possible serait que l’utilisation importante des pesticides s’accompagnerait d’une exposition des riverains ces substances.
Lu pour vous par Jacqueline Géfard
Lettre Info de l’ADPF
Publié le 06 juillet 2018 à 08:38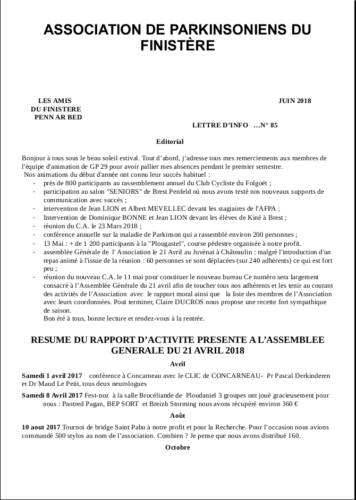
Parkinson iatrogène réponse du Dt Stefan Bohlhalter
Publié le 05 juillet 2018 à 06:54Parkinson Suisse N°129
Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°73
Différents syndromes parkinsoniens sont décrits dans le magazine 113. On y trouve le Parkinson iatrogène, déclenché par certaines substances actives chimiques : de quelles substances s’agit-il ?
Il s’agit principalement de substances qui bloquent les récepteurs dopaminergiques susceptibles de déclencher les symptômes parkinsoniens. La plupart d’entre elles appartiennent au groupe des neuroleptiques, qui sont employés pour lutter contre les maladies psychiatriques (psychoses, hallucinations). Certains médicaments contre la nausée et le mal des transports peuvent aussi exercer un effet inhibiteur sur la dopamine et entraîner des symptômes parkinsoniens. Pour les personnes concernées, il est essentiel de savoir que deux médicaments sont à disposition en cas d’hallucinations visuelles : la quétiapine (par ex. Sequase®) et la clozapine (Leponex®). Elles sont autorisées en raison de leur action anti hallucinatoire ciblée sans interaction avec les symptômes parkinsoniens. En cas de nausée, la dompéridone (Motilium®) ou l’ondansétron (Zofran®) peuvent être utilisés : la première n’agit pas sur le système nerveux central et le mode d’action du second est indépendant de la dopamine.
Lu par Jean Graveleau
Attention, des médicaments prescrits contre la dépression et la maladie de Parkinson accentuent les risques de démence
Publié le 04 juillet 2018 à 08:40Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°73
Incontinence, dépression ou encore maladie de Parkinson… les anticholinergiques sont des médicaments prescrits pour lutter contre ces problèmes de santé. Une équipe internationale de chercheurs (des Etats-Unis, d’Irlande et du Royaume-Uni) a mené l’étude la plus large sur l’impact à long terme de ces traitements. D’après les résultats, publiés dans la revue The BMJ, les anticholinergiques sont liés à des risques accrus de démence.
L’exposition aux anticholinergiques est risquée
Les chercheurs ont analysé plus de 27 millions d’ordonnances appartenant à des patients âgés de plus de 65 ans atteints de démence (40 770) et non-atteints de démence (283 933). Ils ont constaté une plus grande incidence de démence chez les personnes qui s’étaient fait prescrire des anticholinergiques. Par ailleurs, plus les patients avaient été exposés à ces traitements, plus leurs symptômes étaient importants.
La démence entraîne une perte de mémoire, des difficultés à s’orienter et une détérioration du comportement social. Selon une étude américaine très récente, elle tend en revanche à apparaître de plus en plus tard et à durer sur des périodes plus courtes.
Des dégâts bien avant la démence.
Autre découverte, les effets indésirables des anticholinergiques peuvent apparaître bien longtemps avant qu’un médecin diagnostique une démence chez un patient. « Les anticholinergiques, ces médicaments qui bloquent acétylcholine, un neurotransmetteur du système nerveux, ont déjà été déterminés comme une cause potentielle de déficience cognitive », détaille Noll Campbell, l’un des auteurs de l’étude. Il poursuit : « Cette étude est assez vaste pour évaluer les effets à long terme de ces traitements et constater que les dégâts peuvent se faire sentir des années avant que le diagnostic de démence ne soit posé ».
Les chercheurs préconisent ainsi aux médecins de bien évaluer les risques des anticholinergiques sur le cerveau avant de les prescrire. Et aussi d’étudier d’autres options de traitement. Il est possible aussi d’agir sur le mode de vie des patients. Car selon des chercheurs, « au moins un cas sur trois pourrait être évité en arrêtant de fumer, en faisant du sport ou encore en compensant des problèmes d’audition ».
Des millions de personnes concernées :
Analyser les risques de ces médicaments est primordial car ils sont largement prescrits, notamment aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Cela tient aussi du fait qu’ils traitent plusieurs maladies. « Cette étude est très importante car on estime que 350 millions de personnes souffrent de dépression dans le monde », déclare ainsi George Savva, auteur principal de la recherche. Il faut y ajouter les personnes qui souffrent d’incontinence, de la maladie de Parkinson, mais aussi d’asthme ou encore d’épilepsie. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 10 millions de cas de démence sont diagnostiqués chaque année. Aujourd’hui, 50 millions de personnes seraient atteintes dans le monde.
Publié le 26 avril 2018 par Johanna Hébert dans « Pourquoi Docteur ».
Transmis par Martine Delmond
Le rôle protecteur du tabac ?
Publié le 03 juillet 2018 à 08:47Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°73
La diminution du risque de maladie de Parkinson observé chez les fumeurs s’expliquerait par une interaction de plusieurs gènes avec le tabac. Restent à déterminer les mécanismes sous-jacents et les composés de la fumée de cigarette impliqués.
Selon les données épidémiologiques, les fumeurs ont un risque d’être atteints par la maladie de Parkinson inférieur de 40% à celui observé chez les non-fumeurs. Le tabac, bon pour la santé ? Ce constat est suffisamment provocant pour susciter l’intérêt des chercheurs. S’agit-il d’un véritable effet protecteur du tabac lié à un mécanisme biologique ? Ou s’agirait-il d’un biais d’interprétation ?
Pour essayer de répondre à cette question, les interactions entre tabac et génétique viennent d’être étudiées par une équipe constituée autour d’Alexis Elbaz [Note : unité 1018 Inserm/Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines/Université Paris-Sud, Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations, équipe Epidémiologie du vieillissement et des maladies liées à l’âge.]. Selon leurs travaux, deux gènes – RXRA et SLC17A6 – pourraient moduler la relation entre le tabac et la maladie de Parkinson. Parce que les deux protéines codées par ces gènes jouent un rôle dans la neurotransmission, ces travaux soutiennent l’idée d’une protection conférée par le tabac en relation avec un mécanisme biologique sous-jacent. « L’idée n’étant évidemment pas d’inciter les gens à fumer », insiste le chercheur, « mais plutôt d’identifier les molécules qui, dans la fumée du tabac, seraient responsables de cette interaction, ainsi que les mécanismes biologiques impliqués ». Ce qui permettrait éventuellement, à plus long terme, d’envisager des approches de prévention ou même de traitement de la maladie, si ces résultats étaient confirmés.
La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative caractérisée par la destruction progressive des neurones dopaminergiques situés dans la substance noire, une zone du cerveau impliquée dans la motricité. Son apparition reposerait sur des facteurs à la fois génétiques et environnementaux.
Plusieurs gènes ont été identifiés comme pouvant favoriser l’apparition de la maladie mais, pour la plupart, ils ont une faible pénétrance ; en d’autres termes, seule une minorité de porteurs de l’un ou l’autre de ces gènes développe la maladie de Parkinson. En réalité, ces particularités génétiques constitueraient une première marche vers la maladie, mais seule leur interaction avec un ou des facteurs environnementaux – comme l’exposition aux pesticides – les conduiraient à la développer. À l’inverse, les données épidémiologiques qui décrivent moins de malades Parkinson parmi les fumeurs ou ex-fumeurs suggèrent que certaines interactions peuvent être protectrices.
Deux gènes parmi d’autres…
Pour interroger la potentielle interaction du tabac avec les gènes, l’équipe de chercheurs a adopté une approche dénuée d’apriori : elle a choisi de passer en revue 298 gènes impliqués dans la susceptibilité – absorption, transport, dégradation, élimination- aux xénobiotiques (substances étrangères à l’organisme) – afin d’observer si certains d’entre eux étaient distribués de manière différente chez les malades par rapport à des sujets sains, et cela selon leurs habitudes tabagiques – actuels ou anciens fumeurs versus non-fumeurs.
À partir d’une étude française portant sur 513 malades, comparés à 1147 témoins, les analyses génétiques ont mis en exergue 9 polymorphismes nucléotidiques (SNP) impliqués dans une interaction avec le tabac. Deux d’entre eux ont ensuite été confirmés à partir des analyses conduites à partir d’une cohorte américaine regroupant 1 200 sujets malades ou témoins. De façon intéressante, explique Alexis Elbaz, « les gènes porteurs de ces SNP – RXRA et SLC17A6 – codent respectivement pour un récepteur à l’acide rétinoïque impliqué dans le système dopaminergique, et pour un transporteur du glutamate dont la transmission est perturbée dans la maladie ».
« Aujourd’hui, nous devons conduire la même analyse au sein d’une cohorte de patients plus large afin de valider entièrement ces résultats. Ce travail est d’ores et déjà planifié et rassemblera ces prochains mois les données issues de 25 000 patients européens », projette-t-il. « Par ailleurs, nous avons depuis mis en évidence une interaction d’autres gènes avec le tabac ». En effet, en suivant une approche différente, l’équipe a identifié une autre interaction entre le tabac et le gène HLA-DRBA1 dans la maladie de Parkinson. « Ces résultats permettent d’identifier des mécanismes biologiques à étudier : en effet, si ces gènes influencent la relation entre le tabagisme et l’apparition de la maladie, elles constituent autant de pistes à explorer pour décrypter entièrement les mécanismes physiopathologiques initiaux ».
Transmis par Martine Delmond
Guérir la paraplégie et le Parkinson : une PME lavalloise pourrait détenir la solution
Publié le 01 juillet 2018 à 09:01Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°73
La science aurait-elle enfin trouvé le moyen de guérir les lésions traumatiques de la moelle épinière, la maladie de Parkinson, la maladie de Lou Gehrig, l’Alzheimer et les séquelles des accidents vasculaires cérébraux ? Il est encore trop tôt pour dire oui.
Pourtant, surveillez bien l’entreprise lavalloise Fortuna Fix. Cette biotech développe actuellement une solution de régénération de cellules souches neurales qui pourrait bientôt bouleverser l’univers de la médecine.
Située dans les locaux du Centre québécois d’innovation en biotechnologie (CQIB), l’incubateur de l’INRS-Institut Armand Frappier, à Laval Canada, Fortuna Fix est une société dérivée de New World Laboratories.
Créée par un chercheur d’origine finlandaise, Jan-Eric Ahlfors, cette toute petite PME d’à peine dix employés est sur le point d’entamer les essais cliniques de phases I et II de sa nouvelle technologie dans des hôpitaux montréalais, torontois et de Saskatoon. « Des essais seront également réalisés dans des hôpitaux californiens », indique Masha Le Gris Stromme, vice-présidente au développement des affaires chez Fortuna Fix.
« Ces premiers essais vont principalement servir à établir le profil d’efficacité et d’innocuité des cellules souches neurales pour la maladie de Parkinson et pour les lésions de la moelle épinière », poursuit-elle. Éventuellement, des tests pourront être effectués pour les cas d’Alzheimer, de la sclérose latérale amyotrophique (maladie de Lou Gehrig) et sur des patients ayant des séquelles d’accidents vasculaires cérébraux.
Cette technologie de reprogrammation directe a pour avantage d’utiliser les cellules souches neurales des patients eux-mêmes. « Non seulement elles ne requièrent aucun agent immunosuppresseur, mais elles n’utilisent aucun tissu fœtal, embryonnaire ou autre processus posant des problèmes d’ordre éthique », soulève la représentante de Fortuna Fix. Son processus de fabrication entièrement automatisé n’utilise, non plus, aucune manipulation génétique ni aucune composante animale.
C’est grâce à une subvention de 25 Millions $ US, annoncée plus tôt cette semaine, que Fortuna Fix peut désormais procéder à ces premiers essais cliniques. L’argent provient de Salamander Invest, un groupe d’investisseurs norvégiens, et d’Amgen Ventures, une société américaine qui offre son soutien financier aux sociétés de biotechnologie pour le développement de nouvelles thérapies. « C’est la première fois qu’Amgen vient en aide à une organisation spécialisée dans la régénération de cellules souches », signale fièrement Mme Le Gris Stromme.
Qu’est ce qui a poussé un chercheur finlandais à s’établir à Laval, Canada.
Certains se demandent sans doute, ce qui a bien pu motiver un chercheur finlandais à venir s’établir à Laval en 2007 pour développer sa technologie de production de cellules souches neurales ? « L’ex-président Georges W. Bush est en partie responsable », explique Denis Bilodeau, directeur des partenariats en recherches et développements pour New World Laboratories. Au début des années 2000, l’ex-président Bush avait décidé de mettre fin aux subventions pour la recherche des cellules souches régénératives. « La présence d’une forte communauté de chercheurs en médecine régénérative au pays, sans oublier les généreux crédits d’impôts d’Investissement Québec, sont aussi d’autres raisons qui ont convaincu ce chercheur à quitter son laboratoire du Massachusetts pour emménager en sol québécois », explique M. Bilodeau.
Bien que la commercialisation de cette technologie ne soit pas encore pour demain, l’entreprise lavalloise compte doubler son personnel d’ici la prochaine année. Fortuna Fix veut embaucher d’autres chercheurs experts en cellules souches et médecine régénérative. Elle recherche également des spécialistes en assurance qualité, en gestion de projet, en ingénierie biomédicale, en affaires réglementaires sans oublier des rédacteurs scientifiques pour rédiger les résultats des essais… et autres demandes de subventions et bourses qui lui permettront de poursuivre ses recherches et son développement.
Publié le 08/11/2017 à 11h02 par Claudine Hébert
Transmis par Nicole Lecouvey
Propulsé par WordPress et le thème GimpStyle créé par Horacio Bella. Traduction (niss.fr).
Flux RSS des Articles et des commentaires.
Valide XHTML et CSS.