35 – ASSOCIATION de PARKINSONIENS d’ILLE et VILAINE
Publié le 30 octobre 2017 à 09:35Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°70
Cette année, notre sortie annuelle avait lieu à la frontière de notre département, à La Gacilly en Morbihan où deux rendez-vous nous étaient fixés.
Tout d’abord la commune de La Gacilly est devenue l’un des plus grands festivals de photo d’Europe. En effet chaque année ce sont près de 400.000 visiteurs qui ont accès à une trentaine de galeries de photos grand format et à ciel ouvert. Le tout représentant 600 photos. Cette année le thème fort de l’exposition était l’Afrique. L’office du Tourisme ayant mis à notre disposition un guide, la visite était donc animée, commentée, intéressante.
Après un repas convivial situé dans un environnement boisé, nous étions invités toujours à La Gacilly, à visiter le jardin botanique d’Yves Rocher. Ce jardin implanté sur plus de 2 hectares nous conte les relations que tissent l’être humain et le végétal et nous invite au voyage sensoriel au travers des 1.100 plants, fleurs et divers végétaux présentés. Une bambouseraie occupe l’espace et nous la traversons en symbolisant une nature sauvage et exotique. L’entreprise Yves Rocher exploite également sur le site cinquante-cinq hectares de bleuets et de coquelicots, arnica, camomille ces productions servent à la création de parfums de base. L’espace étant également occupé par les abeilles vivant dans les deux cents ruches et sur le site on y recense également cinquante espèces d’oiseaux.
Chaque participant a pu profiter de cette journée de rencontre pour faire part de ses attentes ou pour parler de leur propre expérience. Voilà donc une sortie réussie, sous un temps clément, sortie propre à renforcer les relations que nos adhérents tissent entre eux. Et c’est dans une ambiance chantante que nous avons terminé notre journée festive.
Yves Boccou président
29 – Association de Parkinsoniens du Finistère
Publié le 29 octobre 2017 à 10:11Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°70
C’est la rentrée, il faut se remettre au travail. Dehors, le soleil brille et vous incite à tout sauf à s’installer devant l’ordinateur. Mais, il me suffit de penser à tous les malades de notre Association, à tous les aidants qui les entourent pour me donner du cœur à l’ouvrage. Signalons une innovation sur notre site internet : « GP 29 » où vous trouverez en haut et à droite de la page de garde 2 nouveaux liens « points-rencontres du GP 29 » et « responsables du GP 29 ». Vous trouverez ainsi toutes les informations pour nous joindre très rapidement.
La vie du groupe
Le 29 juin dernier, un groupe de plus de 40 personnes s’est réuni pour un pique-nique à Châteauneuf du Faou. Nous remercions la municipalité de la ville pour la mise à disposition gratuite d’une salle très fonctionnelle. En effet, la météo estivale des jours précédents avait laissé place à une pluie tenace. Mais comme le dit la chanson, le soleil était dans nos cœurs. Jeux, chansons et petites histoires ont agrémentés l’après-midi. Plus de quarante personnes sur plus de 220 adhérents, ce n’est pas beaucoup même en décomptant les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Il faudra faire mieux l’année prochaine.
Dans le courant de l’été, Claire Ducros et Jean Lion ont animé chacun de leur côté, une séance d’information sur la maladie de Parkinson qui ont vivement intéressé leur auditoire. Le 10 août dernier, le club de bridge de l’Aber a organisé un tournoi en notre faveur. Dominique Bonne et François Tosser ont essayé de comprendre en vain les subtilités du bridge. Merci à tous les participants pour leur générosité et leur accueil.
Le 5 septembre prochain, Claire Ducros, assistée de Denise Heydon, Annick & François Tosser intervient devant des bénévoles de l’hôpital de Quimper lors d’une journée de formation sur le rôle des bénévoles dans les hôpitaux avec des malades de Parkinson.
Le 8 septembre 2017, réunion de rentrée du C.A. de l’Association
Les 9 & 10 septembre prochain, lors d’un salon animalier, Louis Arzur, adhérent de notre association, met en vente des peluches fabriquées par ses soins.
Les activités reprennent aux jours habituels à partir du début du mois de septembre 2017 avec 2 changements et une incertitude :
- La première réunion du point-rencontre de Landivisiau aura lieu le 10 octobre ;
- La séance de sophrologie de Morlaix aura lieu le lundi au lieu du mardi et les séances de marche nordique auront lieu le lundi ;
- Nous sommes dans l’attente d’une réponse de la fondation ILDYS quant au financement d’une session de formation en sophrologie sur Landivisiau ;
- Le 3 octobre 2017, participation à une conférence sur la maladie de Parkinson animée par le docteur Kieffer, à l’initiative de la PRO-BTP, à la salle du Roudour à Saint-Martin des Champs ;
- Du 1 au 6 octobre 2017 : rassemblement CECAP à Erdeven à l’initiative de nos amis du Morbihan.
Le 14 Octobre 2017 : participation à une conférence sur la maladie de Parkinson organisée par le C.C.A.S. de Quimperlé.
Pour être complets, signalons le projet « ETPAR » qui suit son cours.
Comme vous pouvez le constater, les activités ne manquent pas : néanmoins l’équipe qui tient le dispositif, aurait un grand besoin de renfort.
Bonne rentrée à tous
Le Président : François TOSSER
22 – ASSOCIATION de PARKINSONIENS des COTES d’ARMOR
Publié le 27 octobre 2017 à 07:55Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°70
Les Cyclos de l’Entente de Saint-Alban
Cette année la Randonnée de la Flora, organisée chaque année par l’Entente Cyclotouriste de Saint-Alban a eu lieu le dimanche 21 mai au profit de APCA. Ils ont roulé pour nous, car deux cyclos de leur Club sont atteints de la Maladie de Parkinson. Une dizaine de nos adhérents ont également participé à leur marche ce jour-là, journée très conviviale, une équipe très sympathique.
Dimanche 2 juillet, nous étions à nouveau les invités des cyclos de St Alban pour partager cette fois leur pique-nique d’été. A cette occasion un chèque de 600 € nous a donc été remis officiellement. Bravo et merci les cyclos ! Pour cette somme bien sûr, mais aussi pour ce geste de solidarité dont les cyclos sont coutumiers. Relayer les bonnes causes, ils connaissent !

Ce buffet campagnard se déroulait dans le cadre de verdure trop méconnu du lac de « Bosméliac » dont peu savent qu’il est la source d’un ruisseau artificiel « la Rigole d’Hilvern », de quelques 70 kms, creusé par nos ancêtres pour alimenter en eau le canal de Nantes à Brest … Un autre ouvrage témoin de la lenteur, mais aussi de la persévérance d’une autre époque, racontée par le Conseiller Départemental Loïc Roscoët, qui pour la circonstance n’avait pas hésité à nous consacrer son temps… encore une fois merci les amis.
Voyage Erquy et la Côte d’Emeraude
Cette année encore, nous avons réalisé un voyage en autocar, une participation financière de l’association permet d’avoir une vrai journée de répit pour tous. C’est ainsi que le mercredi 22 juin, 50 participants des quatre coins du département ont embarqué à Erquy pour la visite guidée de cette belle côte très découpée, avec au passage le Cap d’Erquy, la grande plage des Sables d’Or, avant d’arriver au Cap Fréhel, impressionnant vu de la mer. Le bateau a pu s’approcher au plus près de la réserve ornithologique. Entrée ensuite dans la baie de Frénaye, vue exceptionnelle sur l’imposant château fort de Fort la Latte. Le programme légèrement décalé à cause de la marée, nous a permis d’assister au spectacle des dauphins. Repas frugal au Centre de vacances de Roz Armor, bien connu des habitués AG CECAP, Visite du Port avec un ancien patron pêcheur de Concarneau, déjà rencontré à Plestin Les Grèves pour certains. Balade très appréciée de tous même de Brigitte notre chauffeur.
Visite du petit Musée de Ploubazlanec
Grâce à Gisèle, quelques adhérents du secteur de Paimpol ont eu la chance de découvrir jeudi 20 juillet, avant son transfert, le petit Musée « Mémoire d’Islande ». Dans une petite maison de pêcheur à Ploubazlanec, cette visite, très bien argumentée nous a replongé dans une période très difficile pour toutes ces familles de pêcheurs de Morue. Ils partaient très jeunes bon gré malgré, pour cette île lointaine l’Islande depuis la région de Paimpol. Cette dure vie de pêcheurs a été retracée dans le roman de Pierre Loti « Pêcheur d’Islande ».
Maïté Schivi présidente APCA
Les dons d’organes
Publié le 25 octobre 2017 à 08:49Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°70
En matière d’aide à la recherche, il n’y a pas que les aides financières. On peut aussi faire don de son cerveau. En France, la loi sur les dons d’organe ou de tissus humains stipule que tout le monde est présumé donneur et qu’il appartient à chacun d’exprimer librement son refus. Quoi de plus simple ? Mais qu’en est-il exactement ? Si le don d’organes pour la greffe à visée thérapeutique est bien connu du grand public, en revanche, le don d’organe à des fins de recherche ne jouit pas de la même considération. C’est notamment le cas du cerveau pour lequel l’enjeu est pourtant d’importance pour comprendre les mécanismes intimes de la formation des lésions et de leur retentissement sur le fonctionnement du cerveau. Et pour qui le souhaite, faire don n’est pas si simple. Rien faire ne suffit pas, il faut se signaler…
Mais connaissez-vous Neuro-CEB http://www.neuroceb.org ?
Rédigé par Yves Gicquel
Connaissez-vous mon double ?
Publié le 24 octobre 2017 à 09:23Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°70
Une personne, un double, s’est invité chez moi, une étrange personne qui s’est présentée : « Je suis madame Parkinson, je vais faire le chemin avec vous, je vous accompagne sur le chemin de la maladie ». Qui était cette bizarre dame ? Je lui ai dit : « Dehors, je ne veux pas de çà chez moi ! » J’ai voulu la faire partir, la mettre à la porte, je me suis fâchée, rebellée, j’ai tout essayé, elle était toujours présente.
Depuis, elle est là, je la tolère ; elle est devenue une partie entière de moi. Je sais qu’elle est avec moi, me préparant un tour à sa façon : elle me fait chuter, elle mélange les mots lorsque je veux parler, elle m’empêche de me lever, elle bloque mes pas, elle s’amuse !
Mais je me bats, je l’ignore, bien que je vive avec elle. Je fais de la gymnastique, je lis, je visite des musées, je chante, je m’intéresse à la vie de tous, j’aime les volcans : je me renseigne sur Facebook, je loge une étudiante qui apporte sa jeunesse. Je sens bien que ma façon d’être la dérange, car elle se rappelle durement à moi.
Puisque je ne peux pas la jeter dehors, je vis avec, comme avec mon double ! J’en parle le moins possible, alors je profite du temps présent, du soleil, des choses heureuses, des rencontres avec des amis. Oh ! Je vais à ma vitesse, lentement. Je sais qu’elle se vengera un jour, mais en attendant je l’ignore.
J’ai appris qu’il ne faut pas rester seul (le), que l’on est mieux en groupe et que l’on oublie ainsi Madame PARKINSON!!
Texte de Nicole Lecouvey
Pourquoi le tango est la danse la plus efficace contre Parkinson
Publié le 23 octobre 2017 à 07:43Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°70
Le Pr Gammon Earhart, neurologue à l’Ecole de médecine de l’Université de Washington, a étudié les effets de la danse pour les patients atteints de la M.P.
« Le pas de base du tango est une marche ralentie, dans laquelle on apprend à placer son appui au-dessus d’un pied pour permettre à l’autre de se déplacer, de s’ancrer d’abord avec le gros orteil et de fermement se stabiliser avant d’accepter le poids du corps qui bascule de l’autre côté. » C’est ainsi que le Pr Grammon Earhat, décrit cette danse dans son étude et son analyse des travaux récents sur les effets de la danse pour des patients atteints de la maladie de Parkinson.
Selon lui, les patients doivent alors se concentrer sur une activité qui ressemble à une marche habituelle, ce qui est l’un des piliers des recommandations internationales pour l’exercice physique appliquée à la M.P.: mettre en place des stratégies cognitives du mouvement pour améliorer les transferts. La danse, qui se fait en rythme et en musique, répond également parfaitement à une autre de ces exigences : proposer des points d’ancrage en particulier auditifs et visuels pour améliorer la démarche. Elle facilite l’équilibre en habituant le patient à tenir compte d’événements inattendus : bousculer un autre couple, éviter les pieds de son partenaire ou suivre un mouvement inattendu du meneur.
Mobilité articulaire :
L’équipe de Patricia McKinley, spécialiste en rééducation fonctionnelle à l’Université McGill de Montréal – la première à étudier les effets du tango sur la M.P. – a pu mesurer une augmentation de 4 points des critères d’équilibre sur l’échelle de Berg, mieux que d’autres danses de couple ou que le tai-chi. Enfin, et même s’il ne s’agit pas du but premier de ces ateliers, le tango, comme les autres danses, favorise la mobilité articulaire et le renforcement musculaire, et s’accompagne même – un résultat démontré chez des sujets âgés non atteints par la maladie –, d’une amélioration de la santé cardio-vasculaire.
« Une activité physique soutenue, qui met l’organisme en aérobie, semble favoriser la dégradation métabolique de la fameuses protéine alpha-synucléine », ajoute le Pr Wassilios Meissner, neurologue au Centre Expert Parkinson de Bordeaux, ce qui pourrait jouer sur les symptômes non moteurs de la maladie.
Autre caractéristique spécifique au tango, les pas en arrière et sur le côté en même temps. Le Pr Earhart constate que les chutes – le plus souvent causées par de tels déplacements chez ce type de patients – ont ainsi diminué de moitié après cinq semaines de pratique bihebdomadaire du tango. Enfin, le tango comporte de nombreuses poses et redémarrages, que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson subissent fréquemment lorsque leur corps « >se fige » et auxquels le tango offre des stratégies pour s’habituer à relancer la machine »
Article de Pauline Léna relevé dans le Figaro Santé
Réunion à la direction générale de la santé.
Publié le 22 octobre 2017 à 12:05Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°70
Dans le contexte de rupture de soins des patients atteints de la maladie de Parkinson et bénéficiant de la nicotinothérapie à l’hôpital H Mondor de Créteil, les associations A2N (A2N : association Nicotine et Neurothérapie représentée par Dr Corinne Davin) accompagnée de Jacques Le Houezec tabacologue (participation à NICOPARK 1), Franche Comté Parkinson, Le CECAP (CECAP : Comité d’Entente et de Coordination des Associations de Parkinson représentée Renée Dufant), et France Parkinson ont été reçues par le Pr Benoit Vallet Directeur DGS (Direction Générale de la Santé). Mr François Bruneaux du bureau PP1 était également présent. (Politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins).
Au mois de janvier les Dr M. Berry et C. Davin (A2N) accompagnés de Jacques Le Houezec avaient présenté le dossier concernant la situation alarmante des patients sous nicotinothérapie à Mr B. Vallet. En avril une deuxième rencontre avait eu lieu à laquelle s’étaient associés les Dr Gabriel Villafane et Pr Clanet (responsable du Plan des Maladies Neuro Dégénérative).
Aujourd’hui le Pr B Vallet a présenté le plan de prise en charge des patients sous nicotine. Une liste d’environ 600 patients a été établie. Une lettre co-signée par le Pr Benoît Vallet et Pr Clanet a été envoyée aux 25 centres experts Parkinson. Cette lettre doit permettre la prise en charge des patients proches de chez eux et la possibilité pour les neurologues de prescrire la nicotine dans un cadre compassionnel hors AMM (Autorisation Mise sur le Marché) dans le respect de la liberté de prescription du médecin au patient. Un guide de prescription sera mis à disposition des neurologues par l’association A2N.
Les patients vont également recevoir un courrier cosigné par Mr Martin Hirsch (directeur de l’APHP, Assistance Publique des Hôpitaux de Paris) les informant de la sensibilisation menée sur leur suivi et la disponibilité des centres experts Parkinson de leur territoire pour les recevoir en urgence.
Pour l’instant aucun remboursement des patchs de nicotine n’est envisagé.
Le directeur de la DGS attend des retours des centres, des associations et des patients sur la mise en place de cette prise en charge. Il compte également sur les associations pour relayer l’information auprès des patients.
Le directeur nous a informé qu’il communiquait avec Mr Martin Hirsch et que celui ‑ci avait en charge de gérer la situation à l’hôpital H Mondor.
Compte rendu de la réunion du Collectif Parkinson du 2 juin 2017
Publié le 20 octobre 2017 à 08:01Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°70
Le collectif Parkinson s’est réuni le 2 juin 2017 au siège de France Parkinson.
Présents :
- Daniel DAL-COL : Président de l’Association des Groupements de Parkinsoniens de la Loire (AGPL)
Georges SAUVIGNET : membre de l’AGPL - Jean GRAVELEAU : Président du Comité d’Entente et de Coordination des Associations de Parkinsoniens (CECAP)
- Renée DUFANT : membre du CECAP
- Françoise AGUTTES : membre de la FFGP
- Didier ROBILIARD : Président de France Parkinson (FP)
- Andrée GOUGET : Présidente de Franche-Comté Parkinson (FCP)
- Roger BERTHIER : Président de Parkinsonia
Jean-Paul WAGNER : Président de la Fédération Française des Groupements de Parkinsoniens (FFGP)
Prise de notes assurée par France Parkinson et Renée Dufant

Compte-rendu :
- Rappel de l’entière indépendance des membres du Collectif les uns vis-à-vis des autres. Il n’y a pas un regroupement plus important (sauf en taille!)
- PMND suivit par Florence Delamoye, absente excusée, Didier Robiliard en a fait un court résumé. Un comité de suivi se réunit une fois par mois.
- La journée « souffrance » le 13 juin prochain,
- La recherche en synergie avec l’étranger et notamment la Chine ; dossier suivit par Etienne Hirsch,
- Renforcement des liens des associations et leur reconnaissance par les ARS,
- L’hébergement en EHPAD,
- Les centres experts Parkinson et identification des centres autorisés à pratiquer la « neuro-stimulation »,
- Les centres médico-sociaux avec changement de statut,
- La Nicotinothérapie,
Décisions :
À la suite de ce tour d’horizon, différentes décisions ont été prises :
- Vulgariser les avancées de la recherche pour permettre aux malades et à leurs proches une meilleure compréhension des progrès.
- Exiger un suivi des projets de recherche, avec compte-rendu à la clé.
- Mettre en place des structures spécialisées pour la maladie de Parkinson (Ydes 15).
- Faire agir les ARS au niveau local, qu’elles agissent davantage sur le terrain.
- Trouver un parrain/marraine qui sera l’image de la maladie de Parkinson. Il pourrait s’agir d’une personnalité ou d’un proche (ex : enfant de malade).
- Lors de la prochaine production des « cartes médicales Parkinson », mettre en valeur le Collectif et pas seulement France Parkinson.
- Réfléchir à un logo pour le Collectif.
- Modifier la « mallette du nouveau diagnostiqué » en y mettant des documents plus concis et la distribuer non seulement auprès des centres hospitaliers mais aussi auprès des neurologues en ville.
- Écrire une lettre au Conseiller de santé à l’Élysée et mener une action parlementaire
- Mettre en place une réunion le jeudi 28 septembre à 10h avec le professeur Philippe Remy pour qu’il présente son étude sur la nicotinothérapie.
A la suite de cette réunion du Collectif, Renée DUFANT a été nommée « correspondante animatrice du Collectif ».
Fait à Paris le 7 juin 2017
Rédigé par Renée Dufant et supervisé par Didier Robillard
La qualité de la chaîne du médicament
Publié le 19 octobre 2017 à 09:34Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°70
 Pour parvenir à commercialiser un nouveau médicament, il faut tester un très grand nombre de molécules. Les tests durent plusieurs années, et suivent une succession d’étapes très réglementées. Les nouvelles substances potentiellement actives font ainsi l’objet d’études prévues dans chacune des étapes de développement suivantes :
Pour parvenir à commercialiser un nouveau médicament, il faut tester un très grand nombre de molécules. Les tests durent plusieurs années, et suivent une succession d’étapes très réglementées. Les nouvelles substances potentiellement actives font ainsi l’objet d’études prévues dans chacune des étapes de développement suivantes :
- les essais précliniques consistent à évaluer in vivo dans des systèmes vivants non humains l’activité d’un candidat médicament issus des phases de la recherche cognitive et à appréhender la toxicologie de la molécule. Les études non-cliniques sont conduites en suivant les bonnes pratiques de laboratoire (BPL).
- la phase de développement clinique (essais cliniques = essais d’un médicament chez l’homme volontaire malade ou sain) apporte les preuves scientifiques de la balance bénéfice/risque de la molécule. Cette étape, qui ne peut se faire sans autorisation de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), est cruciale, car les données recueillies viendront alimenter le dossier d’autorisation de mise sur le marché (AMM). Les bonnes pratiques cliniques (BPC) s’appliquent à toutes les étapes de ces études.
Parallèlement aux essais cliniques, il y a une phase de développement industriel qui comprend une phase de production du principe actif et une phase de développement galénique. Le résultat des essais cliniques et du développement pharmaceutique et industriel constitue le dossier de demande d’AMM.
- le dossier d’autorisation de mise sur le marché est la pièce d’identité du médicament. Il regroupe les preuves précliniques et cliniques de sécurité et d’efficacité du médicament. Il démontre également que la chaîne de vigilance et de contrôle mise en œuvre par le fabricant permet d’assurer la reproductibilité de la qualité du médicament. Dans le cadre d’une procédure centralisée européenne, ce dossier est examiné par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne du médicament (EMA). Si la procédure est nationale, le dossier est déposé auprès de l’ANSM. Une partie spécifique du dossier d’AMM est consacrée aux matières premières, qu’il s’agisse de substances actives ou d’excipients, pour apporter la preuve de leur qualité et de leur pureté.
Le saviez-vous ?
Les excipients sont des substances destinées à faciliter la fabrication et l’utilisation. Ils peuvent par exemple apporter un goût, une couleur à un comprimé, un sirop, ou apporter une consistance à une crème, ce qui en facilitera l’application. Ils n’ont pas d’effet thérapeutique mais peuvent avoir un effet notoire qui nécessite des précautions d’emploi pour certaines catégories particulières de patients.
- le processus de production mis en œuvre pour façonner le produit fini est un élément clé de la qualité. Au cours de cette étape, les établissements de fabrication des matières premières actives et les établissements pharmaceutiques appliquent les bonnes pratiques de fabrication (BPF). La fabrication des médicaments est placée sous l’autorité du pharmacien responsable qui engage sa responsabilité pour chaque lot produit.
- la distribution des médicaments est réalisée par des établissements de distribution ayant obtenu une autorisation de l’ANSM. Dans ces établissements toutes les activités (réception des produits, stockage, gestion des commandes, gestion des réclamations…).se font conformément aux bonnes pratiques de distribution (BPD).
- la dispensation des médicaments se fait en officine ou en PUI sous le contrôle d’un pharmacien. Dans ces établissements, les professionnels de santé sont tenus de respecter les conditions de conservation des médicaments dans des locaux ou enceintes adaptés prévues par l’AMM (condition de température…).
- la surveillance post-AMM fait partie intégrante de la qualité de la chaîne du médicament. Après sa commercialisation, le médicament fait l’objet, toute sa vie, d’une surveillance de la part des autorités et des professionnels de santé des pays dans lesquels il est autorisé. Les bénéfices et les risques liés à son utilisation sont périodiquement évalués. Le médicament peut être à tout moment retiré du marché et son AMM suspendue, en cas de doute sur la balance bénéfice/risque de la molécule. L’ANSM publie chaque année, sur son site Internet, la liste des médicaments pour lesquels les AMM ont été refusées, retirées ou suspendues, dont la délivrance a été interdite ou qui ont été retirés du marché en France et dans l’Union européenne (UE).
Point de vue d’un élu associatif : Abattre les cloisons pour être entendu
Publié le 18 octobre 2017 à 08:07Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°70
Régulièrement, lors de nos assemblées, nous avons à déplorer le manque de renouvellement des administrateurs.
Nos associations ont ceci de particulier qu’elles concernent une maladie évolutive qui se manifeste sur le tard. Lorsque les premiers symptômes apparaissent, la maladie est déjà à un stade avancé. Une telle perspective incite peut à s’engager, que l’ont soit aidé ou aidant.
De plus, nous exerçons dans un monde cloisonné, A chaque association sa maladie ! Cela alors qu’elles ont des problèmes similaires à résoudre. Ainsi, chaque rentrée voit le même parcours du combattant où au lieu d’unir leurs efforts, les associations se retrouvent en concurrence face aux organismes censés les aider. Que d’énergie gaspillée !
Le tout aggravé par l’accélération d’un monde livré aux puissants lobbies qui se disputent les parts de marché et face auxquels il devient de plus en plus difficile de faire entendre notre cause.
Comment trouver la force pour abattre les cloisons qui nous éloignent, nous affaiblissent ?
Nous retrouvant entre gens concernés par la même maladie, c’est naturellement que nos préoccupations vont d’abord au « comment aider ? » ou « comment traiter ? » Trop rarement nous nous intéressons au « comment éviter ? » qui pourtant s’adresse à tous — Y compris ceux qui ne sont pas concernés, mais qui par leurs activités pourraient le devenir et ne le savent pas. D’où les journées mondiales organisées pour sensibiliser le grand public sur la maladie, alerter sa vigilance sur la nécessité d’établir des principes de précautions et les faire respecter. Récemment, le gouvernement n’a-t-il pas été amené à revoir à la baisse les règlementations d’utilisation des pesticides dont le lien avec le Parkinson a pourtant été démontré par l’INSERM. Face aux tendances à regrouper les réponses, ne devons-nous pas rapprocher nos causes ? Ne pourrions-nous développer des partenariats pour échanger nos savoirs, voire proposer des terrains d’actions communes ?
Quelques pistes :
httsp://www.generations-futures.fr/actualites/sentinelles-film-cinema-8-novembre/
https://www.letemps.ch/economie/2015/03/11/pesticides-empoisonnent-negociations-entre-americains-europeens
https://www.phyto-victimes.fr/
Rédigé pat Yves Gicquel
Le point rencontre de Brest
Publié le 17 octobre 2017 à 17:42Le point rencontre de Brest s’est déroulée dans la grande salle du patronage du pilier rouge, ce vendredi 15 septembre.
Nous étions environ une vingtaine de personnes malades et aidants. Nous avions mis à disposition de la documentation sur la maladie de Parkinson.
Albert Mévellec responsable du Point rencontre de Brest étant souffrant, nous a demandé Odile et moi de le remplacer.
Nous avons donc accueillis trois malades dont deux que nous avions déjà vus, il y a environ 5 ans. Ces personnes n’étaient pas revenues aux points rencontre car elles ne se sentaient pas prêtes.

Une nouvelle dame déclarée malade depuis un mois et demi a expliqué le parcours de sa vie. Elle a décidé d’emblée de venir nous rejoindre au PR. Tous les trois viendrons rejoindre le groupe de gymnastique douce une fois par semaine au patronage laïque du pilier rouge.
Nous avons donc présenté les dernières informations, la reprise de la gym, des activités, et la mise en place de l’éducation thérapeutique du patient au CHRU hôpital de la cavale blanche à Brest, André un malade a pu d’ailleurs expliquer qu’il avait participé à un atelier d’éducation physique le matin-même au grand large,( port de commerce)
André nous a donc présenté l’organisation de l’atelier pour 9 personnes malades et aidants encadrés par un médecin et Audrey notre kiné du pilier rouge.
Ensuite toutes les personnes présentes ont pu discuter d’un café et thé préparé par notre fidèle Marceline.
[vu sur le net] Point sur l’arrêt de la consultation du Dr Gabriel Villafane au sein du service de neurologie de l’hôpital Henri-Mondor AP-HP
Publié le 17 octobre 2017 à 12:46article trouvé sur le site de l’assistance publique hôpitaux de Paris
Le service de neurologie de l’hôpital Henri Mondor AP-HP héberge un Centre expert Parkinson dirigé par le Pr Philippe Rémy, labellisé par l’ARS Ile-de-France. Le Dr Gabriel Villafane a exercé dans le service de Neurologie à raison d’une demi-journée par semaine, avec une vacation, jusqu’au 1er octobre 2017.
Un protocole d’essai thérapeutique sur l’utilisation de la nicotine à l’état pur comme médicament pour les maladies neurodégénératives, notamment la maladie de Parkinson, a été engagé par le Pr Cesaro (jusqu’à son décès en 2013) et le Dr Villafane. Cette recherche clinique, promue par l’AP-HP avec l’autorisation des autorités compétentes (ANSM et CPP), s’est déroulée de 2009 à 2012 et a concerné 40 patients sur la période. Les résultats de cette étude clôturée permettent de conclure à l’inefficacité de l’administration transdermique de nicotine sur les symptômes moteurs de patients atteints de maladie de Parkinson.
pour lire cet article dans son intégralité, suivez ce lien…
Vaincre la maladie de Parkinson ?
Publié le 10 octobre 2017 à 08:00Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°70
Livre de André Nieoullon
Voici la quatrième de couverture de l’ouvrage du Professeur André Nieoullon paru en mars 2017 chez Deboeck supérieur. Il présente remarquablement son travail de collecte d’informations et de description de la situation des connaissances sur la maladie de Parkinson, connaissances liées à son travail de chercheur à l’université de Aix-Marseille. Aujourd’hui à la retraite, il a tenu à adresser une forme de bilan-état des lieux pour servir à tous les partenaires de référence dans leurs actions.
Très pédagogique, il est parfois pas facile à lire, surtout dans la partie « recherche » qui fait appel à des connaissances que le commun des mortels n’a pas à sa disposition habituellement. Mais cela ne doit pas rebuter le lecteur qui trouvera très certainement des réponses ou des confirmations dans sa connaissance de la maladie.
Quatrième de couverture:-
Pourra-t-on un jour guérir la maladie de Parkinson ?
Cet ouvrage permet d’aborder de manière didactique les différents aspects de la maladie de Parkinson, de sa découverte aux avancés des connaissances les plus récentes sur sa physiopathologie et sa prise en charge. Les progrès sont immenses et pourtant on ne guérit toujours pas cette maladie.
Que fait donc la recherche ?
Chercheur depuis une quarantaine d’années, l’auteur tente de réunir ici les réponse aux questions les plus fréquentes que les patients adressent à la recherche neurologique. Il décrit en particulier comment l’implication de la dopamine a été à l’origine des principaux traitements, et comment la recherche peut aujourd’hui rendre des comptes des causes et des mécanismes de la dégénérescence des neurones, ce qui augure de la mise au point de nouveaux traitements, en particulier à visée neuroprotectrice, pour enfin stopper la maladie de Parkinson.
Pourquoi l’innovation thérapeutique est-elle en « panne » ?
L’ouvrage intéressera les médecins généralistes et neurologues ainsi que les professionnels de la prise en charge des patients parkinsoniens (kinésithérapeute, ergothérapeutes, orthophonistes, infirmières, etc.). il se veut également accessible pour les nombreux malades et associations de malades souhaitant s’informer sur la maladie et en particulier sur les avancées de la recherche et les perspectives thérapeutiques.
Lu et résumé par jean Graveleau
Ce que dit la science à propos des risques et bienfaits du cannabis
Publié le 09 octobre 2017 à 08:00Ce que dit la science à propos des risques et bienfaits du cannabis
Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°70
Le 12 janvier 2017 Even Kinsey, Professeur assistant en psychologie à l’Université de Virginie Ouest, et Divya Ramesh, Chercheuse adjointe à l’Université du Connecticut, déclaraient :
En tant que chercheurs, nous n’avons aucune opinion politique au sujet de la légalisation du cannabis. Nous étudions simplement cette plante, connue sous le nom de marijuana, et ses composantes chimiques.
À ce jour, 29 états américains autorisent l’usage médical du cannabis. Même si d’aucuns prétendent que le cannabis ou les extraits de cannabis peuvent soulager certaines maladies, la recherche sur ce sujet est encore balbutiante, et les résultats obtenus jusque-là sont mitigés. Pour l’instant, nous n’en savons pas assez sur le cannabis et ses dérivés pour juger s’il s’agit d’un médicament efficace.
Alors, quelles sont les données scientifiques disponibles à ce jour, et pourquoi n’en savons-nous pas davantage au sujet de l’usage médical du cannabis ? La plupart des chercheurs s’intéressent à des composantes spécifiques du cannabis, nommées cannabinoïdes. Si l’on s’en tient à un point de vue de chercheur, le cannabis est une drogue « sale », dans la mesure où il contient des centaines de composants dont on ne connaît pas bien les effets. C’est pourquoi les chercheurs se concentrent sur un seul type de cannabinoïde à la fois. À ce jour, seuls deux cannabinoïdes issus de la plante ont été étudiés de façon approfondie : le THC (tétrahydrocannabinol) et le cannabidiol. Mais il se peut que d’autres cannabinoïdes que l’on ne connaît pas encore soient dotés de vertus thérapeutiques.
Le THC est le principe actif principal du cannabis. Il active les récepteurs cannabinoïdes dans le cerveau, provoquant l’effet de « high » bien connu des consommateurs de cannabis, mais il joue aussi sur le foie et sur d’autres parties du corps. Les deux seuls cannabinoïdes approuvés par la FDA (Food and Drug Administration, l’autorité américaine de la santé), que les médecins peuvent donc prescrire légalement, sont des médicaments synthétisés par des laboratoires reproduisant l’effet du THC. Ils sont prescrits pour augmenter l’appétit et prévenir les pertes musculaires associées à certains cancers et au sida.
Le cannabidiol (dit aussi CBD), de son côté, n’interagit pas avec les récepteurs cannabinoïdes. Il ne produit pas non plus de « high ». Aux États-Unis, 17 états ont adopté des lois qui permettent à certains malades d’avoir accès au CBD.
Notre corps produit naturellement des cannabinoïdes, les endocannabinoïdes. Les chercheurs développent des médicaments capables d’altérer leur fonction, afin de mieux comprendre comment fonctionnent les récepteurs de ces substances dans notre organisme. Ces études visent à trouver des traitements qui pourraient utiliser les cannabinoïdes que nous produisons naturellement pour soigner la douleur chronique ou l’épilepsie, au lieu d’utiliser le cannabis issu de plantes.
On entend souvent dire que le cannabis est un traitement possible pour beaucoup de maladies. Observons de plus près deux affections, la douleur chronique et l’épilepsie, pour illustrer l’état actuel de la recherche sur les vertus thérapeutiques du cannabis.
Le cannabis permet-il de lutter contre la douleur chronique ?
Les résultats de la recherche indiquent que certaines personnes souffrant de douleur chronique pratiquent l’automédication avec le cannabis. Cependant, nous disposons de trop peu d’études menées sur les humains pour savoir si le cannabis ou les cannabinoïdes soulagent effectivement la douleur chronique.
La recherche menée sur les humains montre que certaines maladies, comme la douleur chronique résultant de lésions nerveuses, seraient sensibles à l’action du cannabis, sous forme fumée ou vaporisée, de même qu’à un médicament à base de THC autorisé par la FDA. Mais la plupart de ces recherches se fondent sur des déclarations subjectives, sur des évaluations personnelles de la douleur, ce qui en limite la validité. Seuls quelques essais cliniques contrôlés ont été menés à ce jour, ce qui ne permet pas de savoir si le cannabis est un traitement de la douleur efficace.
Une autre approche consiste à s’intéresser à la combinaison de plusieurs médicaments, à savoir un médicament expérimental à base de cannabinoïdes associé à un médicament déjà connu. Par exemple, une étude récente menée sur les souris combinait une faible dose de médicament à base de THC à un médicament de type aspirine. Or, cette combinaison bloque la douleur associée aux terminaisons nerveuses mieux que chacune de ces drogues ne le fait individuellement.
Théoriquement, de telles combinaisons permettent d’utiliser des quantités moindres de chaque substance, et les effets secondaires sont ainsi réduits. En outre, certaines personnes peuvent être plus réceptives à l’une des substances qu’à l’autre, ce qui optimise les chances que la combinaison convienne à plus de patients. Mais pour le moment, aucune étude de ce type n’a été menée sur les humains.
Les effets du cannabis sur l’épilepsie :
Malgré certains articles à sensation et même si les spéculations vont bon train sur Internet, l’usage thérapeutique du cannabis pour atténuer les crises d’épilepsie n’est pour l’instant confirmé que par des expériences menées sur les rongeurs.
Chez les humains, la preuve de son efficacité est bien moins établie. Il existe bon nombre d’anecdotes et d’enquêtes qui vantent les vertus des fleurs de cannabis ou des extraits de cannabis pour traiter l’épilepsie. Mais on ne saurait comparer ces déclarations à des essais cliniques correctement contrôlés qui permettent de déterminer si certains types de crise d’épilepsie répondent positivement aux effets des cannabinoïdes et de donner des indices plus solides sur la façon dont la plupart des gens réagissent à cette substance.
Même si le CBD attire l’attention en tant que traitement potentiel des crises d’épilepsie chez l’humain, on ne sait rien du lien physiologique entre la substance et ses effets. De même qu’avec la douleur chronique, les quelques études cliniques qui ont été menées n’incluent que très peu de patients. En étudiant des groupes plus importants, nous pourrions découvrir si seuls certains patients sont réceptifs au CBD.
Nous avons également besoin d’en savoir plus sur les récepteurs cannabinoïdes dans le cerveau et dans le corps, de comprendre quels systèmes ils régulent, et de quelle façon le CBD peut les influencer. Par exemple, le CBD pourrait interagir avec des médicaments antiépileptiques, mais nous ne savons pas encore très bien dans quel sens. Il pourrait aussi avoir des effets différents sur un cerveau en développement et sur un cerveau adulte. Si l’on cherche à soigner des enfants et des jeunes avec du CBD ou des produits issus du cannabis, il faut se montrer particulièrement prudent.
La recherche sur le cannabis est difficile à mener.
Ce n’est que par le biais d’études solides que nous pourrons comprendre les éventuelles vertus thérapeutiques du cannabis. Mais la recherche sur le cannabis et les cannabinoïdes est particulièrement difficile à mener.
Aux États-Unis, le cannabis et ses composantes, le THC et le CBD, sont surveillés de près par la DEA, la police antidrogue américaine, au même titre que l’ecstasy et l’héroïne. Pour mener des études sur le cannabis, tout chercheur doit d’abord demander une autorisation à l’État et à l’échelon fédéral. S’ensuit un très long processus d’analyse ponctué d’inspections, permettant d’assurer à la recherche un haut niveau de sécurité et une traçabilité maximale.
Dans nos laboratoires, même les toutes petites quantités de cannabinoïdes que nous utilisons pour nos recherches sur les souris sont sous haute surveillance. Ce fardeau réglementaire décourage bien des chercheurs.
La conception des expériences est un autre défi difficile de taille. Beaucoup d’études se fondent sur les souvenirs des consommateurs : ils décrivent leurs symptômes et les quantités de cannabis consommées. On retrouve ce même biais dans toute étude qui se fonde sur des comportements déclarés. En outre, les études menées en laboratoire ne concernent généralement que des consommateurs modérés à fréquents, qui ont déjà certainement développé une certaine accoutumance aux effets de la marijuana et qui, de ce fait, ne sont pas représentatifs de la population générale. Par ailleurs, ces études se limitent à l’usage du cannabis sous sa forme « entière », qui contient de nombreuses sortes de cannabinoïdes dont nous connaissons très mal les effets.
Les essais avec placebo sont également compliqués, parce que l’euphorie que l’on associe généralement à la consommation de cannabis rend la substance facile à identifier, en particulier si elle contient une forte dose de THC. Les gens savent quand ils sont « high » et quand ils ne le sont pas.
Il existe encore un autre biais, que l’on appelle le biais d’espérance, qui revêt un sens particulier avec la recherche sur le cannabis. Ce biais repose sur l’idée que nous avons tendance à expérimenter ce qui correspond à nos espérances, en fonction de nos connaissances. Par exemple, les gens se déclarent plus éveillés après avoir bu un café « normal », même s’il s’agissait en fait d’un café décaféiné. De même, les participants d’une étude sur le cannabis évoquent un soulagement après avoir ingéré du cannabis, parce qu’ils sont persuadés que le cannabis soulage la douleur.
La meilleure façon de surmonter ce biais consiste à mettre en place une étude contre placebo plus sophistiquée. Contrairement à l’étude contre placebo simple dans laquelle les participants ne savent pas ce qu’ils reçoivent, on leur déclare qu’ils reçoivent un placebo, ou une dose de cannabis, sans que cela corresponde forcément à la réalité.
Les études sur le cannabis devraient également inclure des mesures biologiques objectives, telles que le taux de THC dans le sang, ou des mesures physiologiques ou sensorielles que l’on retrouve habituellement dans le champ de la recherche biomédicale. Pour l’heure, les études sur le cannabis mettent en avant des mesures autodéclarées plutôt que des mesures objectives.
La consommation de cannabis n’est pas sans risques.
La possibilité d’une consommation excessive existe pour toute drogue qui affecte le fonctionnement du cerveau, et les cannabinoïdes ne font pas exception à la règle. On peut comparer le cannabis au tabac, car beaucoup de ses consommateurs ont eux aussi du mal à arrêter. Et de même que le tabac, le cannabis est un produit naturel qui a été cultivé de façon sélective pour obtenir des effets plus puissants sur le cerveau, ce qui n’est pas sans risque.
Bien que de nombreux usagers du cannabis soient en mesure d’arrêter sans problème, de 2 à 6% des consommateurs américains éprouvent des difficultés à stopper. L’usage répété de la drogue, en dépit de l’envie de diminuer ou d’arrêter d’en consommer, est le signe d’une dépendance.
Tandis que de plus en plus d’états américains adoptent des lois en faveur de l’usage médical ou récréatif du cannabis, le nombre de personnes dépendantes pourrait bien augmenter.
Il est trop tôt pour affirmer que les bénéfices potentiels du cannabis dépassent les risques qu’il fait encourir à ceux qui en consomment. Mais tandis que les lois américaines sur le cannabis (et le cannabidiol) se font moins restrictives, il est temps que la recherche établisse des faits.
Even Kinsey, Professeur assistant en psychologie à l’Université de Virginie Ouest,
Divya Ramesh, Chercheuse adjointe à l’Université du Connecticut,
La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation, le 12 janvier 2017
Lu par Renée Dufant
[vu sur le net] Parkinson : des malades dénoncent l’abandon d’une thérapie efficace
Publié le 08 octobre 2017 à 11:55article trouvé sur le site de Paris Match
Corinne, atteinte de Parkinson, supporte sa maladie grâce à des patchs transdermiques de nicotine, un traitement expérimental et prometteur. Alors que la direction de l’AP-HP vient de démettre le seul médecin expert sur cette thérapie, des centaines de malades sont dans le désarroi.
pour lire cet article dans son intégralité, suivez ce lien…
Cinéma et théâtre au chevet de la relation médecin patient.
Publié le 08 octobre 2017 à 10:24Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°70
L’enseignement au « savoir-être » médecin à travers la mise en scène de vraie-fausse » consultation, se diffuse peu à peu dans les facultés de médecine. Grâce à cette technique, de plus en plus de facultés forment les futurs médecins à la relation avec le patient.
Œil rivé à la caméra, le jeune homme se concentre sur la scène jouée par les comédiens. L’instant est grave : le médecin annonce à une femme, jeune encore, qu’elle doit subir une chimiothérapie avant son opération d’un cancer du sein. Elle refuse, obstinément : « Ce n’est pas le cancer qui va me tuer, c’est la chimio ». Le médecin s’emporte.
Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas sur le plateau du dernier film de Thomas Lilti, le réalisateur d’Hippocrate et de Médecin de campagne. Derrière la caméra, Mathieu, interne en médecine générale à la faculté Pierre & Marie Curie à Paris. Il inaugure avec sept autres étudiants l’option « médecine, théâtre et vidéos », créée cette année.
L’ambition de ce séminaire n’est pas de révéler des vocations artistiques mais de former de futurs médecins à la relation avec le patient. Transformés en cinéastes pour l’occasion, ils ont imaginé, écrit, joué puis réalisé quatre films mettant en scènes des situations médicales particulières. Au programme :
- l’annonce difficile d’un diabète de type 1 à une jeune fille.
- le refus de soins d’une femme atteinte d’ un cancer du sein.
- un patient se plaignant de symptômes sans causes apparentes.
- une consultation pour une demande d’IVG.
Ces films illustrent comment : l’attitude, les paroles et les silences du médecin lors d’une consultation, influent sur la relation avec le patient.
« Par exemple, dans le film sur la demande de l’IVG, deux ou trois phrases terribles sont assénées. Et nous avons tous, un jour ou l’autre, prononcé ce genre de phrases. Or la première consultation va conditionner le vécu de l’acte », explique le Dr Gilles Lazimi, l’un des enseignants du séminaire. A travers ces exemples, les futurs médecins apprennent à cultiver l’écoute et l’empathie, cette capacité à comprendre ce qui se passe dans la tête de l’autre. « Au cours de nos études, on nous répète qu’il faut être empathique … mais sans nous expliquer comment faire. Pendant les stages, c’est toujours l’aspect technique du métier qui prime », souligne Delphine. La formation des médecins donne en effet la priorité à la recherche des symptômes dans le but d’établir un diagnostic et ensuite de choisir le traitement.
Résultat, les étudiants se retrouvent le plus souvent confrontés à des situations humaines difficiles, sans jamais y avoir été préparés. Comme le raconte Marine, une autre participante « A 20 ans, aux urgences, je me suis retrouvée seule face à une femme de 50 ans suicidaire. J’étais dépassée » Comment alors ne pas être tenté de mettre en place des mécanismes de défense comme refuser de laisser à la place à l’émotion, se cantonner aux traitements …
« Nous avons tous un moment ou un autre perdu notre sensibilité, notre humanité. Mais comment rester empathique à 3 heures du matin aux urgences, lorsqu’un patient vous agresse verbalement ? », s’interroge Delphine.
Apprentissage des gestes techniques :
Pour le Dr Samuel Leroy, qui propose des cours de communication médicale aux étudiants de la faculté de Rouen dès la deuxième année, l’empathie est une fenêtre ouverte sur le monde. « Lorsque votre fenêtre est grande ouverte, si vous vivez une expérience traumatisante, souvent dès votre premier stage, vous la fermez. Nous sommes là pour apprendre aux futurs médecins à manier cette fenêtre, à en moduler l’ouverture », explique l’enseignant. A Rouen, les étudiants sont confrontés à des patients simulés, joués par des acteurs dès la deuxième année.
Cet enseignement au « savoir-être » médecin à travers la mise en scène de « vrai-fausse » consultation demeure facultatif. Il diffuse cependant peu à peu dans les facultés. A l’image de l’apprentissage des gestes techniques, l’idée de « jamais la première fois » avec le malade s’imposera-t-elle dans le domaine de la relation médecin-malade ?
La question reste posée car la méthode a un coût. Pourtant, cette pédagogie réaliste est pertinente, comme l’ont démontré plusieurs études. « Ce dispositif d’enseignement est apprécié des étudiants et leur permet d’en tirer un bénéfice » concluaient en 2006 les chercheurs de l’université de Lausanne qui propose un apprentissage avec patient simulé à tous les étudiants de quatrième année. A Paris, les huit futurs médecins se sentent aujourd’hui mieux armés. « Je suis plus sereine face à certaines situations », explique Naryanne en dernière année. Reste maintenant à toucher le maximum d’étudiants. C’est aussi l’objectif des films qui sont diffusés lors des cours de troisième cycle.
Article d’Anne Prigent relevé dans le Figaro Santé du 20 08 17 par Françoise Vignon
Un infarctus féminin ne débute pas de la même façon que pour un homme.
Publié le 07 octobre 2017 à 10:58Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°70
D’abord, les premiers symptômes ne sont pas aussi dramatiques. La douleur intense tel un coup de couteau à la poitrine ; les sueurs froides, l’impression de serrement puis la chute au sol sont habituellement absents. Voici l’histoire vécue.
Vers 22h30, sans aucun avertissement préalable, sans activité exténuante ou stressante, j’ai subi un infarctus du myocarde. J’étais assise bien confortablement avec mon chat lors d’une soirée froide d’hiver. Une bonne lecture m’occupait et me faisait penser : ça, c’est la vie… les pieds surélevés bien assise dans ma chaise.
 Quelques instants plus tard, j’ai eu l’impression d’une mauvaise indigestion. Je me sentais comme si j’avais avalé en toute hâte un sandwich puis un verre d’eau pour faire descendre le tout. J’avais la sensation d’avoir avalé une balle de golf et qu’elle parcourait lentement mon œsophage en me laissant une grande sensation d’inconfort. J’ai donc eu comme réflexe d’aller boire un verre d’eau pour faire descendre le tout mais je n’avais rien mangé depuis au moins 5 heures. Ces premiers symptômes se sont dissipés puis j’ai senti une drôle de sensation de serrement et de mouvement tout le long de ma colonne vertébrale ce que j’ai attribué plus tard à un spasme de l’aorte. Puis cette sensation s’est transmise au niveau du sternum puis est montée jusqu’à mon cou puis s’est logée aux deux mâchoires.
Quelques instants plus tard, j’ai eu l’impression d’une mauvaise indigestion. Je me sentais comme si j’avais avalé en toute hâte un sandwich puis un verre d’eau pour faire descendre le tout. J’avais la sensation d’avoir avalé une balle de golf et qu’elle parcourait lentement mon œsophage en me laissant une grande sensation d’inconfort. J’ai donc eu comme réflexe d’aller boire un verre d’eau pour faire descendre le tout mais je n’avais rien mangé depuis au moins 5 heures. Ces premiers symptômes se sont dissipés puis j’ai senti une drôle de sensation de serrement et de mouvement tout le long de ma colonne vertébrale ce que j’ai attribué plus tard à un spasme de l’aorte. Puis cette sensation s’est transmise au niveau du sternum puis est montée jusqu’à mon cou puis s’est logée aux deux mâchoires.
C’est alors que j’ai réalisé que je subissais sans doute un infarctus car j’avais en mémoire les informations quant aux raisons des douleurs des mâchoires. Mon premier réflexe fut de repousser le chat et de me lever mais mes jambes ne me supportèrent pas.
Je me retrouvai donc au sol et réalisai alors que je ne devais pas me déplacer mais puisque j’étais seule, je devais me rendre au téléphone dans la pièce voisine avant de perdre tous mes moyens. Je me suis donc relevée en m’appuyant sur une chaise et j’ai marché lentement vers le téléphone pour appeler à l’aide. La préposée m’envoya immédiatement les secouristes suite à l’écoute de mes symptômes. Elle me conseilla de déverrouiller la porte d’entrée puis de m’étendre tout près afin que les ambulanciers me trouvent rapidement. Je me suis alors étendue sur le sol puis je suis devenue inconsciente.
Je n’ai aucun souvenir de leur intervention ni de mon voyage en ambulance. Arrivée aux urgences, je me rappelle à peine le cardiologue dans ses vêtements bleus de salle d’opération qui tentait de m’interroger mais sans succès. Je repris conscience un peu plus tard alors que les médecins avaient inséré le minuscule ballon sonde dans l’artère fémorale pour se rendre jusqu’à l’aorte. On dut installer deux appareils pour maintenir l’aorte coronarienne dégagée.
En réalité, toute cette démarche s’est faite très rapidement, l’espace de quelques minutes car les services d’urgence se trouvent assez près de mon domicile. J’ai subi un arrêt cardiaque lors du déplacement mais la vigilance de tous m’a sauvé la vie.
Voici donc quelques conseils :
- Soyez consciente que quelque chose de très inhabituel se passe en vous, rien qui ne ressemble à quoique ce soit que vous avez déjà senti. La douleur très caractéristique au niveau du sternum puis des mâchoires m’a convaincue de l’infarctus. Plus de femmes que d’hommes succombent à leur première attaque car elles n’évaluent pas la gravité des symptômes. Leur premier réflexe étant de prendre un médicament pour une indigestion tel du Maalox ou un antiacide, elles se couchent ensuite et se disent que demain elles iront mieux mais pour elles, ce lendemain n’arrive pas… Vos symptômes ne seront peut-être pas identiques mais un appel, même s’il s’avère une fausse alarme vaut plus que de risquer votre vie.
- Ne perdez pas de précieuses minutes en conjoncture de toutes sortes. Ne pensez pas conduire ou même de vous faire conduire par un être aimé. Les ambulanciers sont équipés pour vous donner rapidement les soins essentiels à votre survie. Ne tentez pas de rejoindre votre médecin, il ne peut rien pour vous, le temps est trop précieux. Les ambulanciers vous donneront le précieux oxygène dont votre corps ne peut se passer.
- Même si votre taux de cholestérol est normal, cet accident cardio-vasculaire est possible. Des recherches ont indiqué que l’infarctus n’arrive que si un taux exagérément élevé de cholestérol est aussi accompagné d’une tension artérielle très élevée. Le cholestérol seul ne cause habituellement pas l’infarctus. Ce sont surtout le stress à long terme et des dérangements causés par un cocktail hormonal qui intoxiquent notre système. La douleur aux mâchoires peut être tellement intense qu’elle peut nous éveiller. Donc soyez vigilantes. Une femme bien informée peut avoir la vie sauve.
Un cardiologue croit que si dix femmes reçoivent cette information et la font suivre à dix autres femmes, au moins une vie pourra être sauvée… Alors faites passer.
Transmis par Renée Dufant
Résultats prometteurs de l’étude du diabète de type2 dans le traitement de la maladie de Parkinson
Publié le 06 octobre 2017 à 11:01Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°70
Les premiers signes montrent une meilleure fonction motrice et un ralentissement possible de la progression de la maladie. Mais une plus grande recherche est nécessaire.
Dr Patrik Brundin
La preuve continue de démontrer qu’une classe plus récente de médicaments antidiabétiques appelés mimétiques d’incrétine ou d’agonistes de récepteurs peptidiques de type glucagon peut ralentir ou arrêter la progression de la maladie de Parkinson. Cependant, les scientifiques font remarquer que d’autres recherches sont nécessaires pour déterminer si ces médicaments sont sûrs et efficaces chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.
Les dernières nouvelles proviennent d’un essai clinique récent au Royaume-Uni, dans lequel certaines personnes atteintes de Parkinson ont conservé plus de fonction motrice après avoir pris une exénatide pendant 48 semaines que les patients qui ont pris un placebo. Même trois mois après l’arrêt de la thérapie exénatide, les patients traités ont conservé une fonction motrice plus élevée que le groupe témoin.
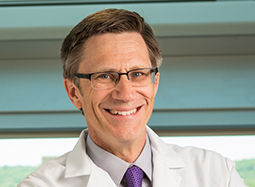 « Comme toujours avec des études sur un petit nombre de patients, nous devons examiner ces résultats avec prudence, mais ils pourraient signaler un tournant dans le traitement de Parkinson », explique Patrik Brundin, MD, Ph. D, Directeur du Centre de sciences neurodégénératives de l’Institut de recherche de Van Andel et président du Comité d’essais cliniques liés (LCT) de The Cure Parkinson’s, qui examine chaque année plusieurs médicaments qui pourraient être réutilisés à partir d’autres maladies pour traiter la maladie de Parkinson. « L’examen scientifique approfondi effectué par LCT est essentiel pour trouver des médicaments existants adaptés à la maladie de Parkinson ».
« Comme toujours avec des études sur un petit nombre de patients, nous devons examiner ces résultats avec prudence, mais ils pourraient signaler un tournant dans le traitement de Parkinson », explique Patrik Brundin, MD, Ph. D, Directeur du Centre de sciences neurodégénératives de l’Institut de recherche de Van Andel et président du Comité d’essais cliniques liés (LCT) de The Cure Parkinson’s, qui examine chaque année plusieurs médicaments qui pourraient être réutilisés à partir d’autres maladies pour traiter la maladie de Parkinson. « L’examen scientifique approfondi effectué par LCT est essentiel pour trouver des médicaments existants adaptés à la maladie de Parkinson ».
En 2012, LCT a donné la priorité à une version à temps lent d’exénatide en tant que candidat principal pour l’évaluation clinique. Les succès dans les essais récents valident le potentiel de LCT pour apporter de nouvelles thérapies et l’espoir pour les 10 millions de personnes dans le monde qui vivent avec la maladie de Parkinson.
Les chercheurs dirigés par le neurologiste Thomas Foltynie, Ph. D, MBBS, au University College London, ont mené l’étude en partenariat avec The Cure Parkinson’s Trust, une organisation britannique à but non lucratif dédiée à trouver un remède contre la maladie de Parkinson ; La Fondation Michael J. Fox pour la recherche sur la maladie de Parkinson, qui a financé le procès, et Astra Zeneca, qui a fourni le médicament et le placebo.
Des efforts sont déjà en cours pour lancer un essai plus vaste et multi-centre pour déterminer si l’exénatide pourrait être utilisé comme un traitement pour ralentir la progression de la maladie.
« Ces résultats sont certainement prometteurs, mais nous avons besoin de beaucoup plus de recherche et d’essais cliniques plus larges pour évaluer l’ampleur des effets de l’exénatide et s’il est possible pour les patients atteints de Parkinson de le prendre pour de plus longues périodes en toute sécurité », explique Brundin.
« Des études en laboratoire nous ont dit depuis des années que les faillites du métabolisme cellulaire peuvent être au moins partiellement responsables de la mort des cellules du cerveau dans la maladie de Parkinson », explique Brundin En outre, nous observons les connexions entre le métabolisme de l’énergie altérée et la capacité des cellules du cerveau à gérer la protéine alpha-synucléine qui est susceptible de s’accumuler dans la maladie de Parkinson. »
Pour ces raisons et plus encore, le leadership du Comité des essais cliniques liés a donné la priorité à plusieurs médicaments contre le diabète de type 2, y compris l’exénatide, pour un traitement potentiel de la maladie de Parkinson.
La dernière étude a porté sur 60 patients atteints de maladie de Parkinson, dont 30 ont reçu des injections hebdomadaires d’exénatide et 30 ont reçu un placebo. Le dossier complet de l’étude est disponible sur clinicaltrials.gov.
« Des études comme celle-ci donnent de l’espoir et suggèrent que nous sommes plus proches que jamais d’un médicament qui pourrait ralentir la progression de la maladie de Parkinson », explique Brundin. « Nous sommes prudemment optimistes, mais invitons les cliniciens et les patients à attendre pour ajouter des médicaments tels que l’exénatide aux régimes de traitement jusqu’à ce qu’ils soient prouvés sûrs et efficaces dans la maladie de Parkinson. »
Transmis par Martine Delmond
Un rappel : le rôle de Lévodopa
Publié le 05 octobre 2017 à 06:09Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°70
La Lévodopa (ou L‑dopa) est un précurseur de la dopamine. Son principe est simple : elle vient pallier le manque de dopamine. Son effet est quasi immédiat sur les tremblements, le ralentissement, le blocage. Ce médicament est administré par voie orale ou dans certains cas sous forme de gel injecté dans le jéjunum (partie de l’intestin) par le biais d’une pompe (pompe à Duodopa). Les effets secondaires. Les nausées et vomissements sont les plus immédiats. On peut aussi observer de la confusion mentale et des hallucinations. Cependant son action est si bénéfique sur les troubles du malade qu’elle est parfaitement acceptée. C’est la seule famille thérapeutique qui sera prescrite jusqu’au bout.
http ://www.medisite.fr/parkinson-quels-sont-les-traitements.296178.16548.html#ai3GXdKEhgk4ueIi.99
Rédigé par Martine Delmond
La protéine alphasynucléine parasite la maladie de Parkinson — Mais elle peut également protéger notre intestin
Publié le 04 octobre 2017 à 12:11Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°70
Les dommages cérébraux remarquables dans la maladie de Parkinson sont considérés comme le travail d’une protéine parasite qui se propage d’une cellule du cerveau à une cellule du cerveau comme une infection. Maintenant, les chercheurs ont constaté que la forme normale de la protéine α‑synucléine (αS) peut réellement défendre les intestins contre les envahisseurs en marquant les cellules immunitaires clés. « Mais les infections intestinales chroniques pourraient finalement causer la maladie de Parkinson », suggèrent les scientifiques, « si αS migre des nerfs surchargés dans le mur de l’intestin vers le cerveau ».
« L’axe immunitaire intestinal semble être à l’origine d’une explosion de nouvelles idées, et ce travail offre une nouvelle hypothèse exceptionnellement excitante », explique Charles Bevins, un expert en immunité intestinale à l’Université de Californie, Davis, qui n’était pas impliqué dans l’étude.
La fonction normale de αS a longtemps été un mystère. Bien que la protéine soit connue pour s’accumuler dans des touffes toxiques dans le cerveau et les nerfs de la muqueuse dans les patients atteints de la maladie de Parkinson, personne n’a été sûr de ce qu’elle a fait chez les personnes en bonne santé. Notant qu’une région de la molécule αS se comporte de manière similaire à de petites protéines ciblant les microbes qui font partie des défenses immunitaires du corps, Michael Zasloff, un immunologiste du Georgetown University Médical Center à Washington DC, a cherché à savoir si αS, aussi, pourrait aider à repousser les envahisseurs microbiens.
Pour voir si αS jouait effectivement un rôle dans les défenses immunitaires de l’intestin, Zasloff, Ethan Stolzenberg du Centre des sciences de la santé de l’Université de l’Oklahoma à Oklahoma City, et leurs collègues ont passé 9 ans à collecter et à analyser les biopsies du duodénum – la première partie de la L’intestin où les nerfs produisent normalement très peu d’αS – de 42 enfants susceptibles d’avoir une maladie de Parkinson. (Les premiers stades de la maladie n’apparaissent presque jamais avant l’âge adulte.) Les enfants souffraient de douleurs abdominales, de diarrhée, de vomissements et d’autres symptômes gastro-intestinaux, ainsi que de l’inflammation intestinale visible sous un microscope. Les scientifiques ont constaté que la protéine αS était effectivement présente dans les nerfs de l’intestin enflammé — et plus le tissu était intensément enflammé, plus l’équipe en a trouvé.
Mais l’αS était-elle une cause ou un effet de l’inflammation ? Pour les découvrir, les chercheurs se sont tournés vers des biopsies de 14 enfants et de deux adultes qui ont reçu des transplantations intestinales et ont ensuite développé des infections par le norovirus, un pathogène intestinal commun. La plupart du temps, la protéine αS était très évidente lors de l’infection. Dans quatre des neuf patients – dont les intestins ont été biopsiés avant, pendant et après l’infection – la protéine αS n’est apparue que pendant l’infection, mais pas auparavant. (Zasloff conjecture que les cinq patients qui ont montré une production de αS avant l’infection le faisaient en réponse à une autre infection virale préexistante).
Ensuite, les scientifiques ont demandé si la protéine αS agissait comme un aimant pour les cellules inflammatoires, qui constituent une partie clé d’une réponse immunitaire normale. Dans les expériences sur les plats de laboratoire, ils ont constaté que αS, que ce soit dans sa conformation normale ou dans les agrégats mal repliés trouvés dans la maladie de Parkinson, avait attiré puissamment les globules blancs qui sont présents dans l’inflammation aiguë et chronique. Ils ont également découvert que les deux formes de cellules dendritiques activées par αS, qui conduisent à une immunité durable en présentant des morceaux d’envahisseurs étrangers aux lymphocytes – les globules blancs qui se souviennent d’intrus microbiens spécifiques et qui réagissent en force aux invasions ultérieures. Après avoir exposé les cellules dendritiques immatures à αS pendant 48 heures, l’équipe a découvert que plus il a de αS plus les cellules dendritiques étaient activées. Ensemble, les données suggèrent que la production de αS par les nerfs dans la paroi intestinale est la cause – et pas l’effet – de l’inflammation des tissus, les auteurs écrivent aujourd’hui dans Journal of Innate Immunity : « Cette découverte nous montre que le système nerveux [intestinal] peut jouer un rôle clé dans la santé et la maladie », dit Zasloff.
Les auteurs notent que les personnes ayant des copies multiples du gène qui dirigent la production de αS développent inévitablement la maladie de Parkinson – en substance, la production de la protéine accable la capacité du corps à la dégager, et elle forme les agrégats toxiques qui causent la maladie de Parkinson. Ils écrivent également que les infections intestinales aiguës ou chroniques répétées pourraient produire « une augmentation comparable » dans αS.
Les résultats du document sont « passionnants », affirme Arletta Kraneveld, une immunopharmacologue qui étudie l’axe du cerveau à l’Université d’Utrecht aux Pays-Bas. « C’est la première [étude] montrant qu’une protéine très, très pertinente pour la maladie de Parkinson est capable d’induire une réponse immunitaire. Il ouvre de nombreuses avenues pour de nouvelles recherches. »
Zasloff lui-même s’installe dans la clinique, traitant les patients atteints de Parkinson pour constipation en utilisant une version synthétique de la squalamine, un stéroïde naturel fabriqué par le requin-chien. La squalamine, dit Zasloff, entraîne un mouvement intestinal et bloque l’action αS dans les nerfs de la muqueuse intestinale. L’essai de première phase est mené par Enterin, un cabinet basé à Philadelphie en Pennsylvanie, par Zasloff, fondé avec son co-auteur, la neurologie Denise Barbut, aujourd’hui médecin hygiéniste d’Enterin. Si le médicament réussit à inverser la constipation, les chercheurs concluront qu’il a perturbé la fonction de αS dans les nerfs intestinaux. « Ce type d’approche pourrait également modifier en principe toute l’histoire naturelle de la maladie », dit Zasloff.
Mais David Beckham, neurovirologiste et médecin de l’Université de Denver, est prudent. « Potentiellement, αS joue un rôle dans l’aide aux neurones pour lutter contre les infections » dit-il. Mais il ajoute que l’étude actuelle ne fait pas assez pour montrer que c’est une cause et non un effet de l’inflammation.
« C’est une première partie d’une nouvelle compréhension émergente de ce que cette molécule pourrait faire », dit Beckham. « Et je pense qu’il va éventuellement nous guider dans la bonne direction quant à ce qui se passe mal dans la maladie de Parkinson — et potentiellement comment pouvons-nous l’empêcher ».
Publié dans : DOI : 10.1126 / science.aan7025 La biologie, Brain & Behavior, Santé
Rédigé par Meredith Wadman 27 juin 2017, 16h30
Transmis par Martine Delmond
Propulsé par WordPress et le thème GimpStyle créé par Horacio Bella. Traduction (niss.fr).
Flux RSS des Articles et des commentaires.
Valide XHTML et CSS.
